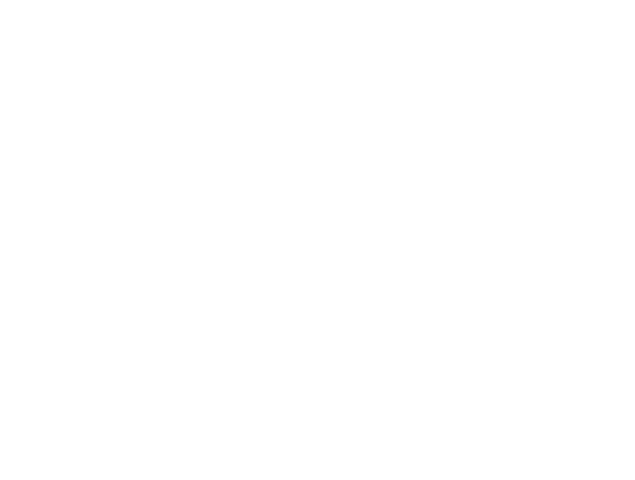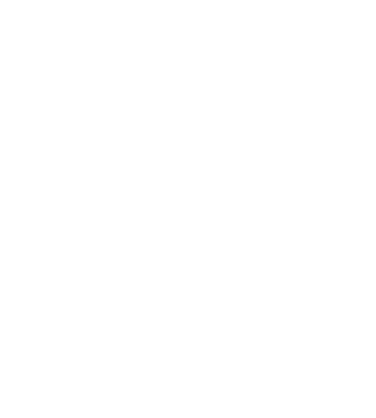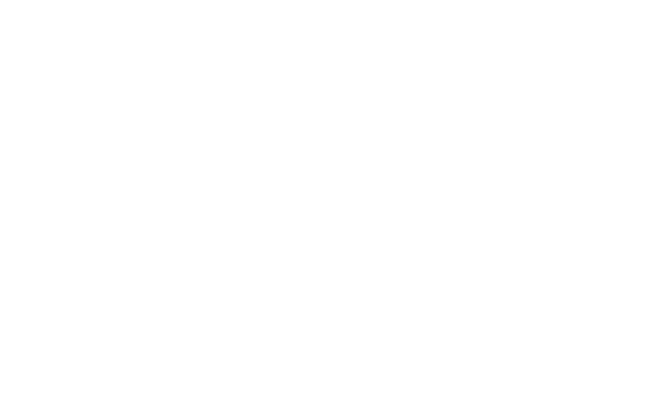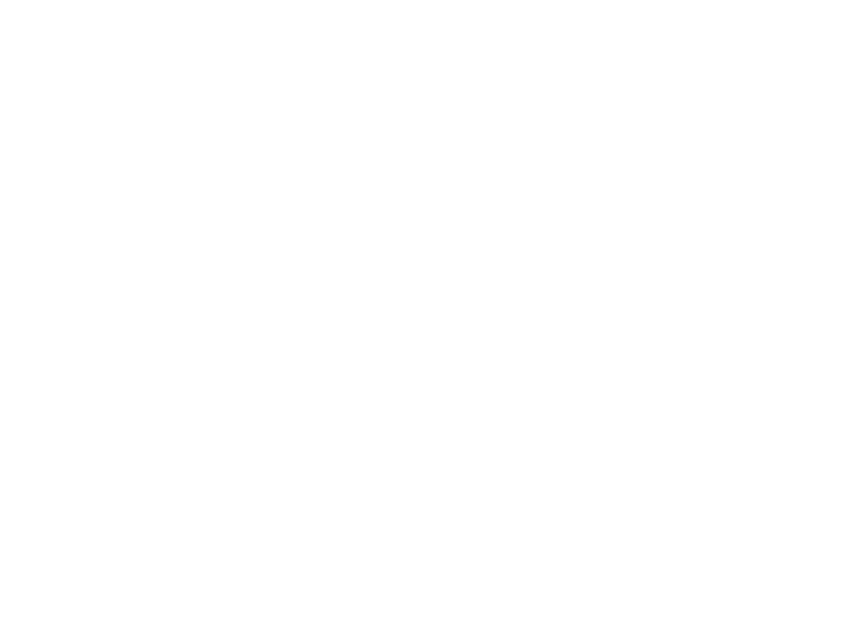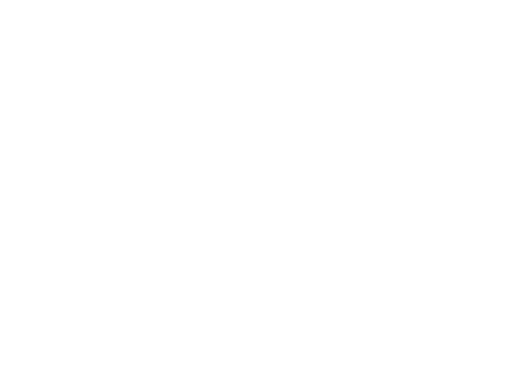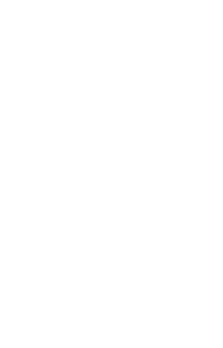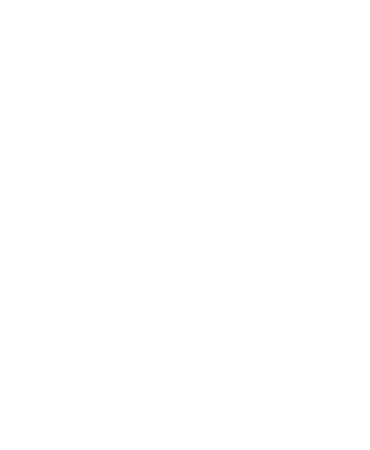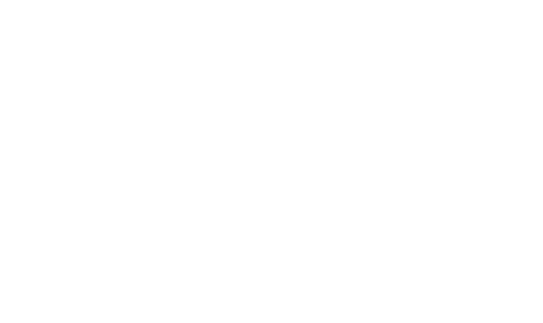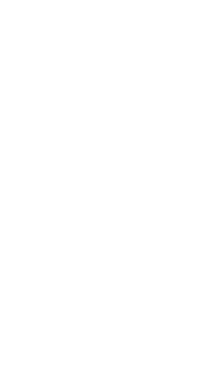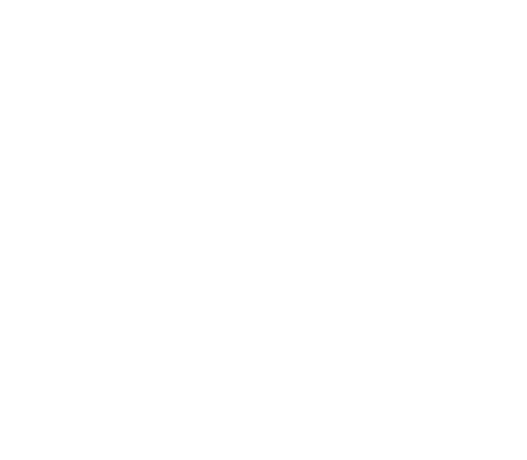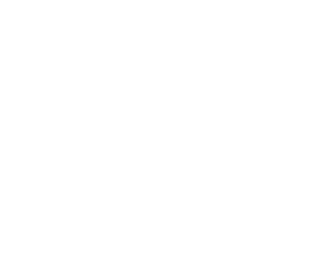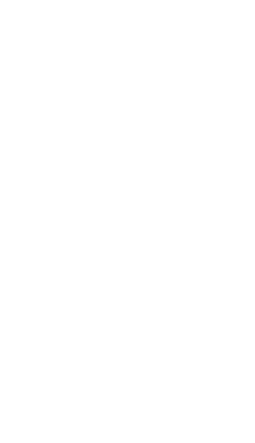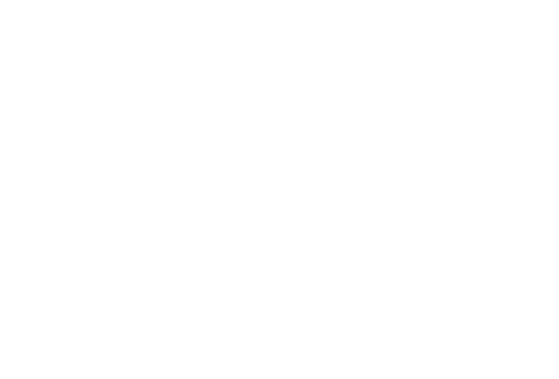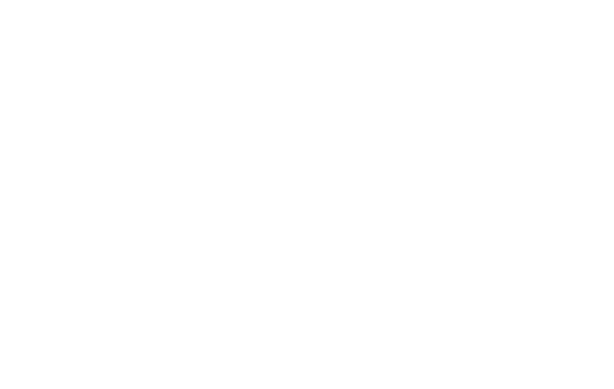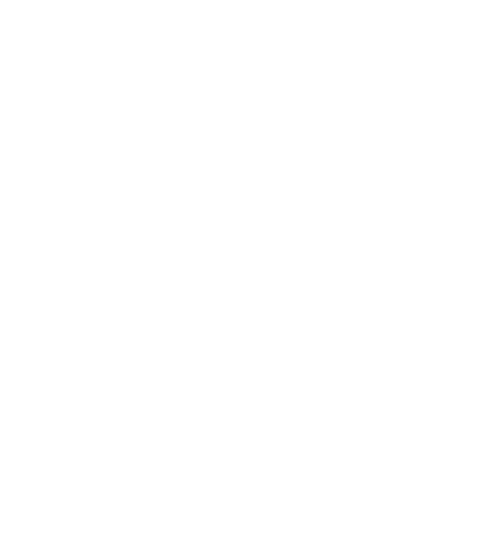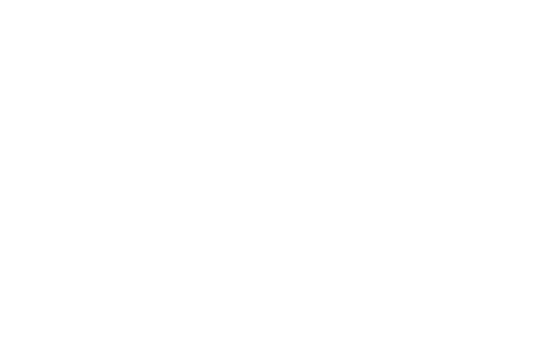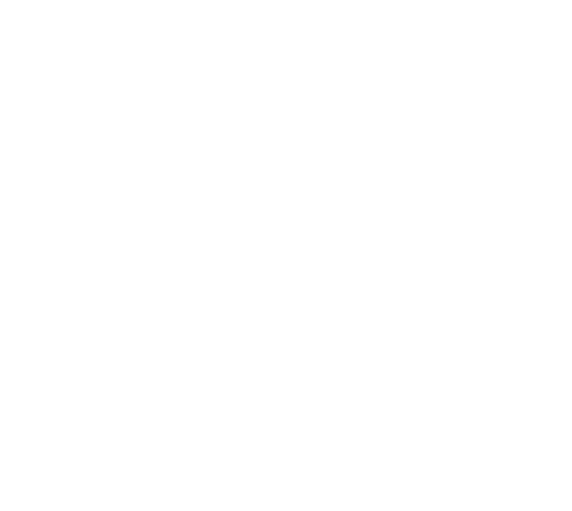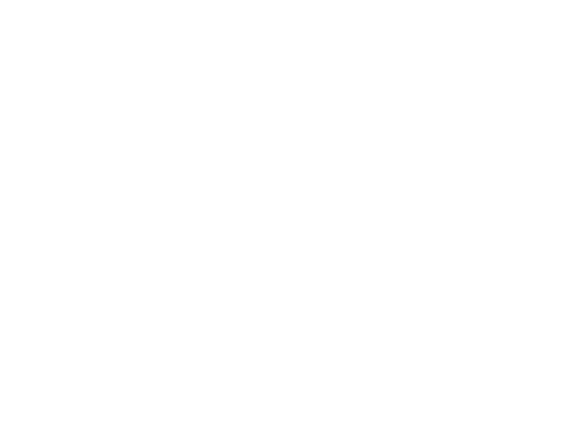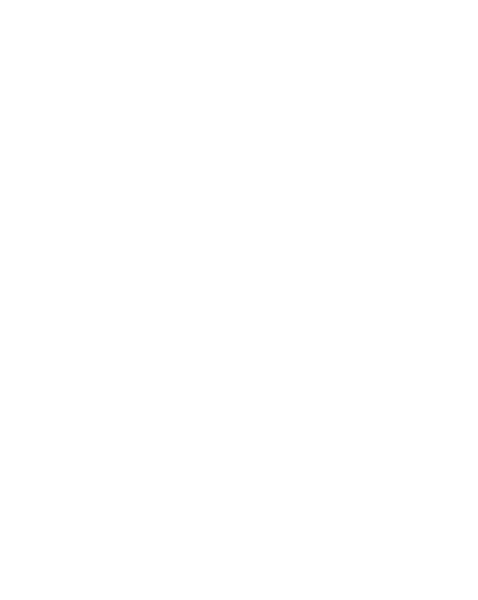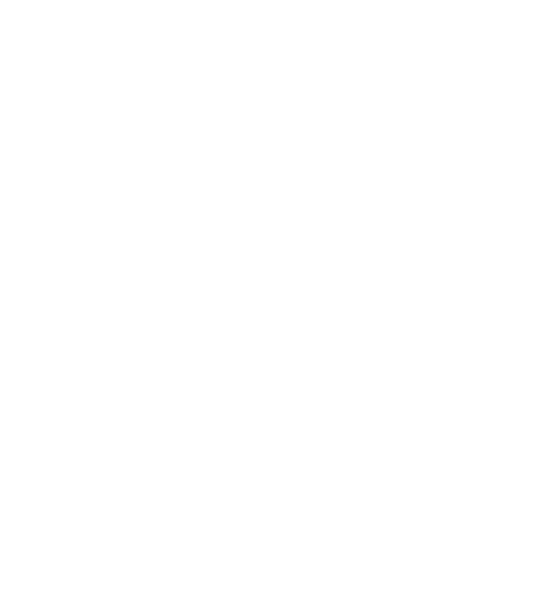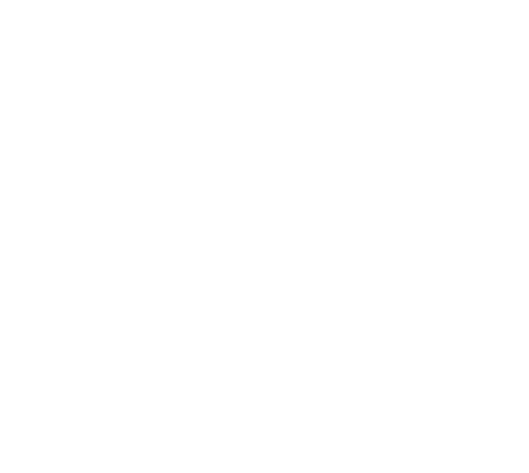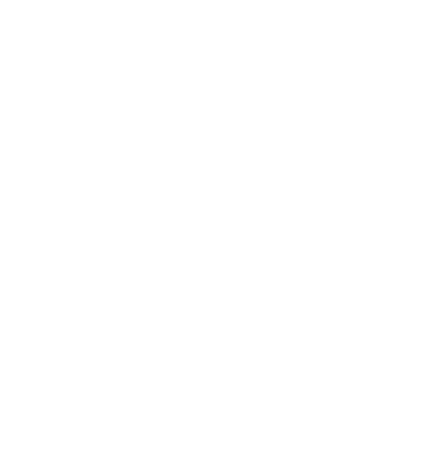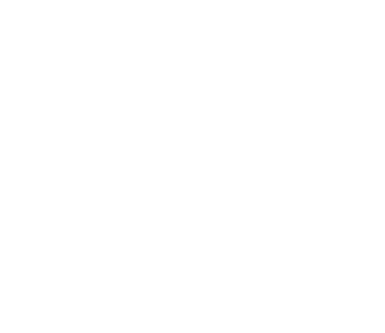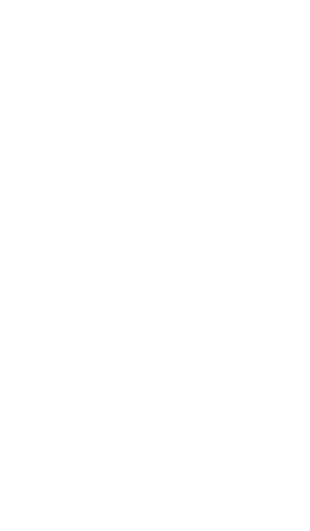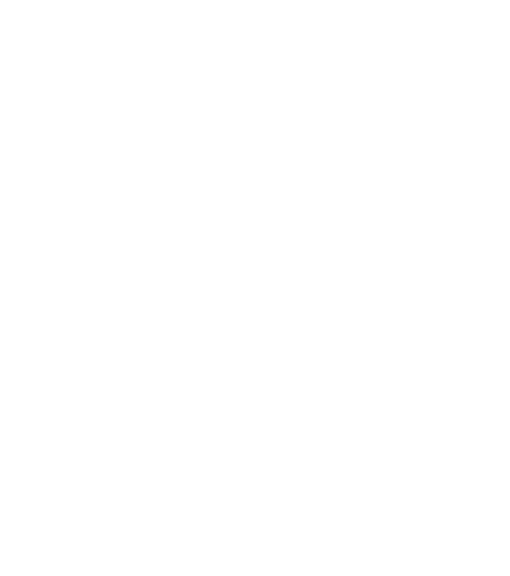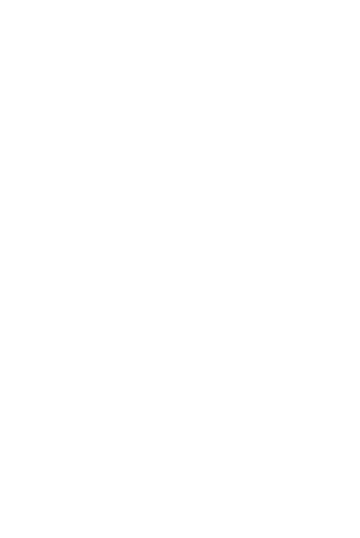William Congdon (1912-1998):
une épopée
du regard
ou l'image
qui sauve
une épopée
du regard
ou l'image
qui sauve
"Pour vous présenter le parcours de la vie et de l'art de Congdon – d'ailleurs très étroitement liés – j'ai voulu souligner que tous les deux sont marqués par de brusques tournants, on peut dire: des conversions.
On peut en envisager au moins cinq, auxquels correspondent autant de lieux où il a habité, puisqu'il a été un artiste-voyageur
(un Énée, en quelque sorte)."
Rodolfo Balzarotti
On peut en envisager au moins cinq, auxquels correspondent autant de lieux où il a habité, puisqu'il a été un artiste-voyageur
(un Énée, en quelque sorte)."
Rodolfo Balzarotti
1 – un refuge dans l'art – un faux départ: la sculpture – Nouvelle Angleterre
Il naît dans une famille très riche de Providence, Rhode Island. sur la côte Est des États Unis, le 15 avril 1912, la nuit même où le célèbre paquebot Titanic coulait dans l'Océan. Cette tragédie va marquer sa vie comme une sorte de signe du destin. Il sera, justement, un artiste-voyageur (même dans les grands paquebots des années 30-50) et il aura à partager les grandes tragédies du XX siècle, qu'il traversera presque d'un bout à l'autre (il mourra le 15 avril 1998).
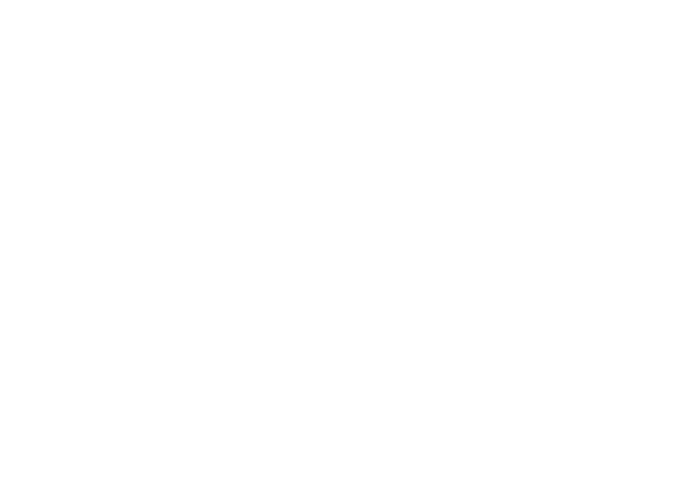
Providence, The Port, 1947, gouache et crayon sur papier
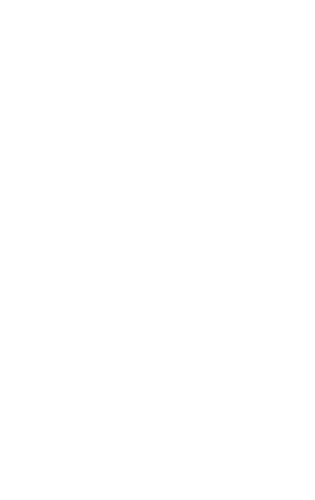
Bill (à gauche) avec son frère ainé Gilbert
Dans le milieu privilégié de sa famille, il connaît très tôt la souffrance, la solitude, un sentiment d'étrangeté, la peur d'être refusé, pas accueilli ou accepté. Une blessure profonde fait surgir en lui les grandes questions de la vie, et le désir brûlant d'un confort: dans les voyages et tout ce qui lui donne l'illusion de fuir un milieu qui l'étouffe. mais surtout dans la beauté, la beauté de la mer, des grands bateaux, des paysages, de la musique, de l'art et de la poésie.
Après l'université, il obtient la permission de se consacrer à l'art, et précisément à la sculpture qu'il apprend avec un maître privé à Boston. Il faut dire que ce fut pour lui une sorte de pis-aller, étant donné qu'il se sentait un inadapté, incapable d'entreprendre une profession sérieuse dans le monde des affaires.
Il va apprendre surtout le modelage de la figure humaine et du portrait. À la fin des années 30 il commence une activité professionnelle. Voici un échantillon de 1940.
Après l'université, il obtient la permission de se consacrer à l'art, et précisément à la sculpture qu'il apprend avec un maître privé à Boston. Il faut dire que ce fut pour lui une sorte de pis-aller, étant donné qu'il se sentait un inadapté, incapable d'entreprendre une profession sérieuse dans le monde des affaires.
Il va apprendre surtout le modelage de la figure humaine et du portrait. À la fin des années 30 il commence une activité professionnelle. Voici un échantillon de 1940.
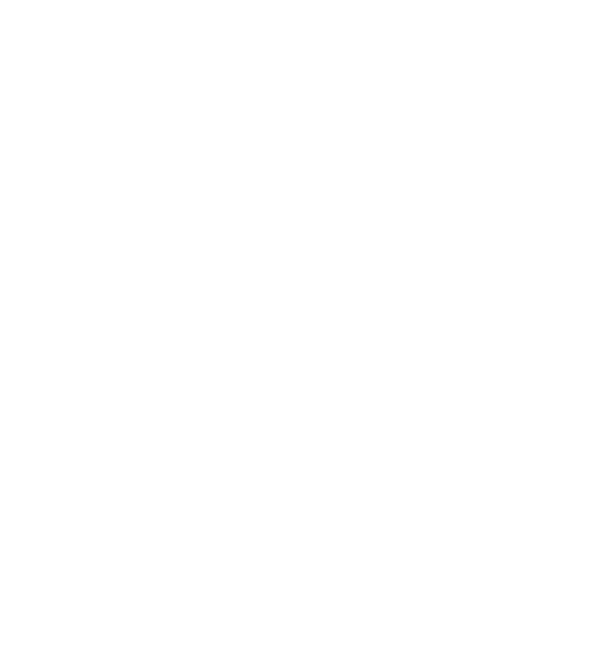
An de Grâce, bronze, 1940
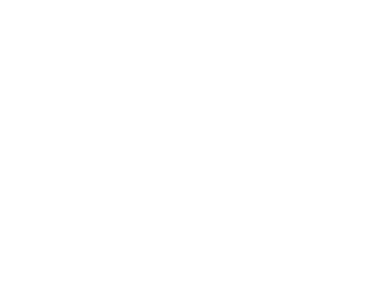
Mère en deuil, plâtre, 1940
Ce qui nous frappe c'est la récurrence du thème de la Pietas, la compassion, avec ces espèces de Mater dolorosa. La guerre a déjà commencé en Europe et déjà il est sensible aux événements de l'histoire.
Au-delà d'un certaine déformation expressionniste, ces oeuvres semblent ignorer les grandes révolutions de l'art du 20° siècle. On peut parler d'un faux départ: on peut lui reconnaître du talent, mais pas de génie, pas le courage de se risquer dans des nouvelles voies.
Au-delà d'un certaine déformation expressionniste, ces oeuvres semblent ignorer les grandes révolutions de l'art du 20° siècle. On peut parler d'un faux départ: on peut lui reconnaître du talent, mais pas de génie, pas le courage de se risquer dans des nouvelles voies.
2 – Le choc de la guerre et la conversion à la peinture: la plongée dans le contemporain - New York
Sa véritable naissance comme artiste, se fera seulement après une brusque et longue interruption de son activité due au fait que son pays en 1941 entre en guerre et que l'année suivante il s'enrôle dans un corps d' ambulanciers volontaires où il fera l'expérience de trois campagnes militaires, en Afrique du nord, en Italie, et en Allemagne. Pendant trois, quatre ans il ne pourra rien faire d'autre que des dessins pour documenter les horreurs de la guerre. S'il ne peut pas produire grande chose, cette expérience, pourtant, produit un changement profond dans sa conscience d'homme et d'artiste. Pendant la guerre, il assiste à des événements qui, pour lui, seront aussi des visions révélatrices.
La première vision c'est celle de la célèbre abbaye de Montecassino complètement détruite par un bombardement en 1944.
La seconde, encore plus terrifiante, c'est celle de la mort en masse dans le champ de concentration de Bergen Belsen en Allemagne, en avril, mai 1945, où il restera plus d'un mois pour porter secours aux internés.
La première vision c'est celle de la célèbre abbaye de Montecassino complètement détruite par un bombardement en 1944.
La seconde, encore plus terrifiante, c'est celle de la mort en masse dans le champ de concentration de Bergen Belsen en Allemagne, en avril, mai 1945, où il restera plus d'un mois pour porter secours aux internés.
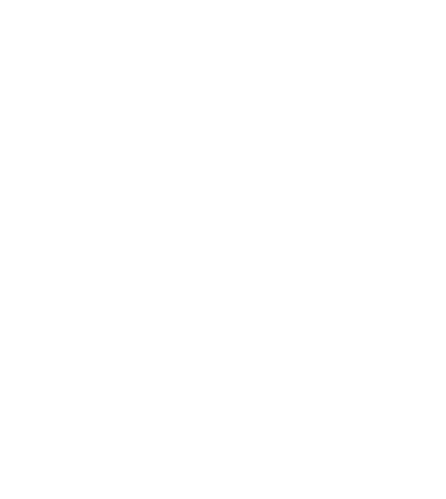
Congdon avec son ambulance en Nord Afrique, 1942-43 env.
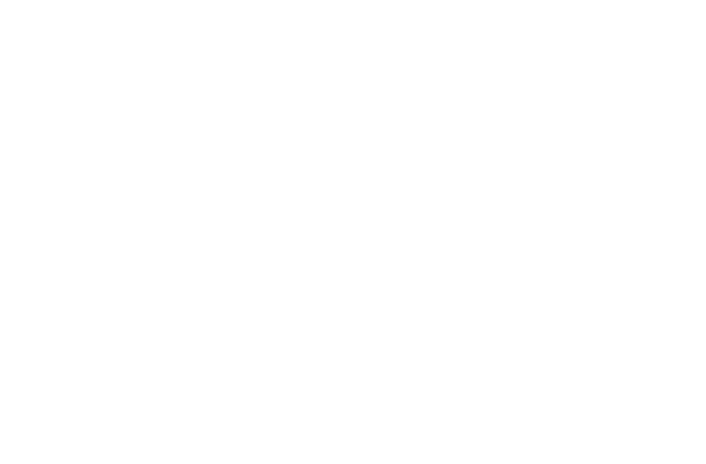
“Morgen Tod", Belsen Concentration Camp, 1945, crayon sur papier
Un jour il découvre dans une baraque une femme juive encore vivante qui lui dit qu'elle va mourir le lendemain. Congdon, impuissant à lui sauver la vie, prend du papier, un crayon et se met à faire son portrait. La femme, en s'en apercevant, se recoiffe.
Ces deux spectacles lui font découvrir que l'homme est capable d'effacer en lui-même et dans les autres sa propre image humaine. Et pas seulement son propre visage individuel, mais aussi le visage communautaire, collectif de son habitation, les signes et les symboles de la civilisation.Par ailleurs, en faisant le portrait de la femme, même de façon inconsciente, Congdon va découvrir une valeur nouvelle –mais aussi très ancienne –du portrait: c'est un geste pour arracher à la mort le visage humain. L'art a en soi une valeur intime de salut, de rédemption. Et toute sa vie il sera fidèle à cette idée.Après le choc de la guerre et cette nouvelle prise de conscience de l'art, il décide de se consacrer à la peinture qu'il ne pratiquait pas depuis des années. Comme a écrit Fred Licht, son exégète le plus autorisé:
«C'est un état d'urgence qui a fait que Congdon prenne conscience de l'art. Pas un processus mais une conversion, instantanée, irrévocable. Depuis les tout premiers débuts, l'art de Congdon devait se développer sous le signe de ce qui peut être résumé en un seul mot : Pietas» (Fred Licht)
Les trois années suivantes, de 1946 à 1949, il a environ 35 ans, il doit se réinventer un nouveau langage, et il doit le faire à bout de souffle, presque à partir de zéro.
Quand il arrive à New York en 1948, il trouve des compagnons de route convaincus comme lui que, après les horreurs de la guerre et la hantise atomique de l'après-guerre, l'humanité a besoin d'une révolution spirituelle à travers l'art. C'est la nouvelle avant-garde de l'art, qui prendra le nom d' Action painting. Avec eux il expose à la galerie Betty Parsons et il va apprendre une nouvelle liberté expressive, le courage de se risquer.
Ces deux spectacles lui font découvrir que l'homme est capable d'effacer en lui-même et dans les autres sa propre image humaine. Et pas seulement son propre visage individuel, mais aussi le visage communautaire, collectif de son habitation, les signes et les symboles de la civilisation.Par ailleurs, en faisant le portrait de la femme, même de façon inconsciente, Congdon va découvrir une valeur nouvelle –mais aussi très ancienne –du portrait: c'est un geste pour arracher à la mort le visage humain. L'art a en soi une valeur intime de salut, de rédemption. Et toute sa vie il sera fidèle à cette idée.Après le choc de la guerre et cette nouvelle prise de conscience de l'art, il décide de se consacrer à la peinture qu'il ne pratiquait pas depuis des années. Comme a écrit Fred Licht, son exégète le plus autorisé:
«C'est un état d'urgence qui a fait que Congdon prenne conscience de l'art. Pas un processus mais une conversion, instantanée, irrévocable. Depuis les tout premiers débuts, l'art de Congdon devait se développer sous le signe de ce qui peut être résumé en un seul mot : Pietas» (Fred Licht)
Les trois années suivantes, de 1946 à 1949, il a environ 35 ans, il doit se réinventer un nouveau langage, et il doit le faire à bout de souffle, presque à partir de zéro.
Quand il arrive à New York en 1948, il trouve des compagnons de route convaincus comme lui que, après les horreurs de la guerre et la hantise atomique de l'après-guerre, l'humanité a besoin d'une révolution spirituelle à travers l'art. C'est la nouvelle avant-garde de l'art, qui prendra le nom d' Action painting. Avec eux il expose à la galerie Betty Parsons et il va apprendre une nouvelle liberté expressive, le courage de se risquer.
Congdon dans son atelier à New York dans un service du magazine "Life", 1950 env.
Encouragé par le langage inouï du "dripping": "l'égouttement" de Pollock, Congdon commence à travailler de façon directe, spontanée, en laissant de l'espace à l'improvisation et à l'imprévu.
Les instruments de Congdon
Congdon en peignant dans son atelier de Buccinasco (Milano), photo de Elio Ciol (détails)
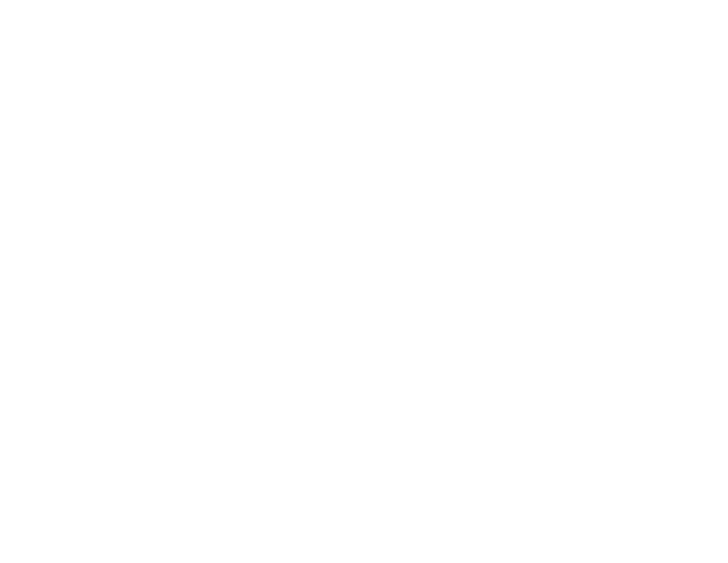
Venise 9, 1951 (détail), huile, émail, or et argent
Mais dès le début, il va se distinguer de ses collègues par ses couches de couleur très épaisses, et l'utilisation exclusive de la spatule sur une surface dure, résistante, en bois ou parfois même en métal, sur une préparation noire. Enfin un poinçon avec lequel il va inciser, graver dans les couches de couleur.Une façon de peindre qui contient en elle-mêmeune certaine violence, où effacer et construire vont de pair. Et puis, avec les couleurs à l'huile il mêle l'or et l'argent qui donnent une qualité métallique à ses surfaces tourmentées et en même temps miroitantes.
«Peut-être suis-je encore sculpteur» dira-t-il toujours.
Mais l'autre changement radical est dans le choix du motif, du sujet: la figure humaine disparaît totalement, remplacée, après quelques tentatives d'abstraction, par les vues urbaines.C'est toujours l'homme qui l'intéresse, mais investi dans son habitat, dans cette coquille qu'il crée autour de lui-même pour se protéger, pour donner forme et signification à sa vie mais qui parfois est aussi une cage, un labyrinthe.
Mais l'autre changement radical est dans le choix du motif, du sujet: la figure humaine disparaît totalement, remplacée, après quelques tentatives d'abstraction, par les vues urbaines.C'est toujours l'homme qui l'intéresse, mais investi dans son habitat, dans cette coquille qu'il crée autour de lui-même pour se protéger, pour donner forme et signification à sa vie mais qui parfois est aussi une cage, un labyrinthe.
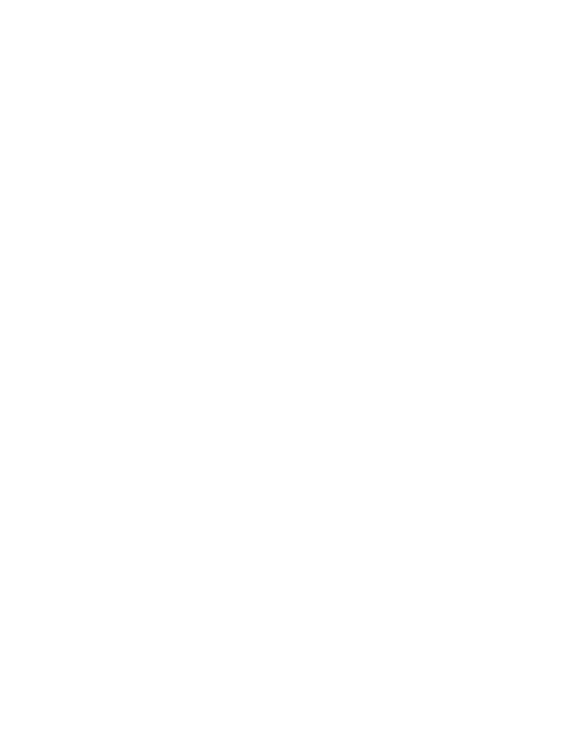
Black City, 1949, huile, émail et encre sur table
Au début, il peint les façades des quartiers dégradés de New York, puis il passe aux vues d'ensemble de la ville. Ce sont les premières oeuvres importantes de sa carrière, où il commence à se former son propre langage, en 48 et 49.
La structure sérielle, répétitive de la métropole se prête à un jeu presque abstrait de gribouillage, qui donne une texture serrée et nerveuse, comme une résille. Il pratique un dessin où la ligne ne trace jamais le contour d'une forme, mais fait un parcours labyrinthique qui se reprend toujours et qui a une valeur non seulement spatiale mais temporelle, musicale, rythmique, dansante. C'est le nouveau jargon de l'art de l'après-guerre.Le chef d'oeuvre de cette période est la Cité Noirede 1949.
Écoutons son propre commentaire:«New York, 1949 -En moi, l'image de la cité haute et profonde se conçoit, elle devient la cité noire, pleine de coups de griffes, déchiquetée par les néons; de même mes tableaux: pleins d'entailles.New York. Le visage de la cité: toute une trame noire dans la nuit, confuse, tortueuse, soulevée par des lumières égarées et flottantes où je tailladais comme pour détruire.La cité noire est vue d'en haut, à vol d'oiseau; sa structure est donc constituée d'une seule masse comme prise dans une résille.Les villes sont toujours pour moi des personnes. Je peins l'architecture, mais à travers les tensions humaines qui la construisent.»
La structure sérielle, répétitive de la métropole se prête à un jeu presque abstrait de gribouillage, qui donne une texture serrée et nerveuse, comme une résille. Il pratique un dessin où la ligne ne trace jamais le contour d'une forme, mais fait un parcours labyrinthique qui se reprend toujours et qui a une valeur non seulement spatiale mais temporelle, musicale, rythmique, dansante. C'est le nouveau jargon de l'art de l'après-guerre.Le chef d'oeuvre de cette période est la Cité Noirede 1949.
Écoutons son propre commentaire:«New York, 1949 -En moi, l'image de la cité haute et profonde se conçoit, elle devient la cité noire, pleine de coups de griffes, déchiquetée par les néons; de même mes tableaux: pleins d'entailles.New York. Le visage de la cité: toute une trame noire dans la nuit, confuse, tortueuse, soulevée par des lumières égarées et flottantes où je tailladais comme pour détruire.La cité noire est vue d'en haut, à vol d'oiseau; sa structure est donc constituée d'une seule masse comme prise dans une résille.Les villes sont toujours pour moi des personnes. Je peins l'architecture, mais à travers les tensions humaines qui la construisent.»
3 – Conversion au passé – le voyage vers l'Est et vers le passé; embrasser le cosmos et l'histoire – Venise
À New York, en 1949, Congdon a plongé dans l'art contemporain, participant d'une véritable révolution dans le langage de l'art, au moment où –mais on ne le savait pas encore à ce moment-là –New York va remplacer Paris comme centre de l'art international.
Et que fait Congdon? Il part, il laisse New York et son Pays pour aller s'installer à Venise. Désormais il vivra comme un expatrié. C'est une autre conversion, dans le sens le plus littéral du mot: il tourne le dos à l'Ouest pour aller vers l'Est, il détourne son regard du présent pour le diriger vers le passé.Il est curieux de voir ce qu'il écrivait à propos du rapport entre New York et Venise:
Et que fait Congdon? Il part, il laisse New York et son Pays pour aller s'installer à Venise. Désormais il vivra comme un expatrié. C'est une autre conversion, dans le sens le plus littéral du mot: il tourne le dos à l'Ouest pour aller vers l'Est, il détourne son regard du présent pour le diriger vers le passé.Il est curieux de voir ce qu'il écrivait à propos du rapport entre New York et Venise:
«Venise était toute une image, comme New York... Toutes les deux sont des rêves de pierres sur la mer.»
Et encore:
«Venise résiste au présent et s'accroche au passé avec la même ténacité avec laquelleNew York résiste au passé et brûle pour le futur.»
En déménageant à Venise, en 1950, il va vivre désormais comme un expatrié. C'est une autre conversion, au sens aussi bien géographique que temporel.
D'une part, on voit ici comment Congdon regarde et sent les villes: elles sont le «rêve»des hommes, les projections matérielles de leurs aspirations.
Et puis il voit en même temps une appartenance mutuelle et une opposition entre New York et Venise, qui s'exprime dans le chiasme contenu dans la seconde phrase.
C'est comme si New York lui avait fait faire ce virage vers l'Europe, vers Venise. Et à son tour Venise va lui ouvrir la porte vers l'Orient des civilisations méditerranéennes, vers la Grèce, Byzance, et au delà... L'Orient, c'est-à-dire l'origine de la civilisation.
Sa peinture va prendre un aspect plus figuratif. On le voit dans l'image de la basilique du Rédempteur qui se reflète dans l'eau du canal, en formant une nouvelle figure de la même consistance. En renversant le tableau, on peut voir que ce reflet prend la forme d'une Madone byzantine.
Mais on voit aussi quelle transformation d'échelle la Basilique subit par rapport au contexte urbain.
D'une part, on voit ici comment Congdon regarde et sent les villes: elles sont le «rêve»des hommes, les projections matérielles de leurs aspirations.
Et puis il voit en même temps une appartenance mutuelle et une opposition entre New York et Venise, qui s'exprime dans le chiasme contenu dans la seconde phrase.
C'est comme si New York lui avait fait faire ce virage vers l'Europe, vers Venise. Et à son tour Venise va lui ouvrir la porte vers l'Orient des civilisations méditerranéennes, vers la Grèce, Byzance, et au delà... L'Orient, c'est-à-dire l'origine de la civilisation.
Sa peinture va prendre un aspect plus figuratif. On le voit dans l'image de la basilique du Rédempteur qui se reflète dans l'eau du canal, en formant une nouvelle figure de la même consistance. En renversant le tableau, on peut voir que ce reflet prend la forme d'une Madone byzantine.
Mais on voit aussi quelle transformation d'échelle la Basilique subit par rapport au contexte urbain.
La basilique du Rédempteur, 1952, huile, émail sur table
En général, ces vues urbaines et monumentales des années 50 ont plusieurs traits en commun:
A –Ce sont de véritables scénographies, où l'ombre et la lumière prennent un aspect solide. Ce sont des masses denses d'ombre et de lumière dans lequelles les formes des édifices sont incisées au poinçon avec des gribouillages linéaires qui leur donnent au contrarie un aspect léger, presque inconsistant.
A –Ce sont de véritables scénographies, où l'ombre et la lumière prennent un aspect solide. Ce sont des masses denses d'ombre et de lumière dans lequelles les formes des édifices sont incisées au poinçon avec des gribouillages linéaires qui leur donnent au contrarie un aspect léger, presque inconsistant.
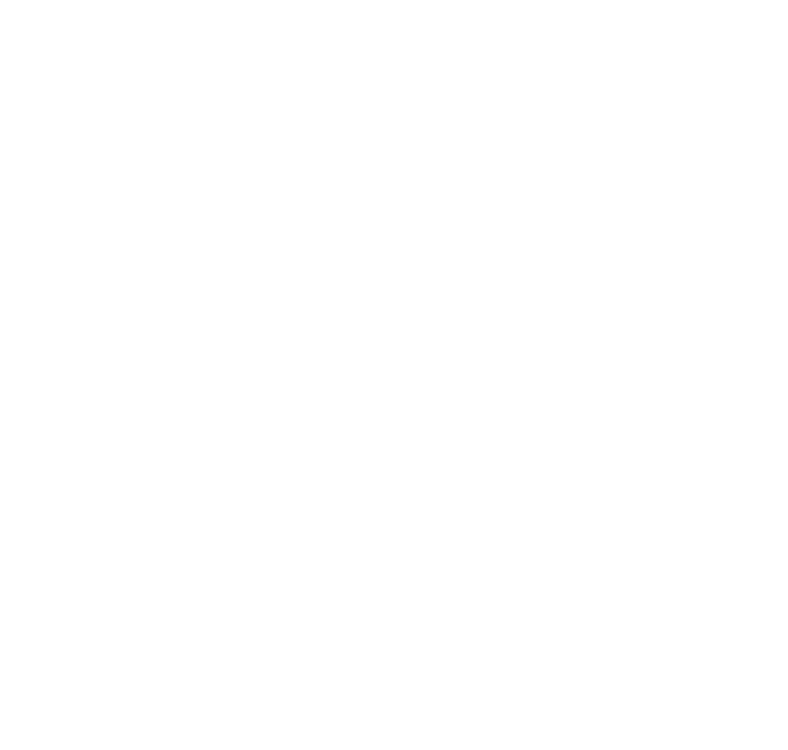
Venise 9, 1951, huile, émail, or et argent sur table
Athènes 2 (Eurechthyon), 1953, huile et or sur table
Istanbul 3, 1953, huile et or sur table
B - Ce sont toujours des vues à vol d'oiseau qui vont déformer les espaces, en y introduisant des cassures, des failles, des dénivelés, avec des effets d'effondrement ou, au contraire, d'élévation. En somme, une véritable dramatisation de l'espace par les édifices.
Nancy, 1954, huile et or sur table
Saint Germain-en Laye, 1954, huile et or sur table
C – Mais surtout ces architectures donnent un sens d'instabilité, de précarité: elles sont toujours "chancelantes".
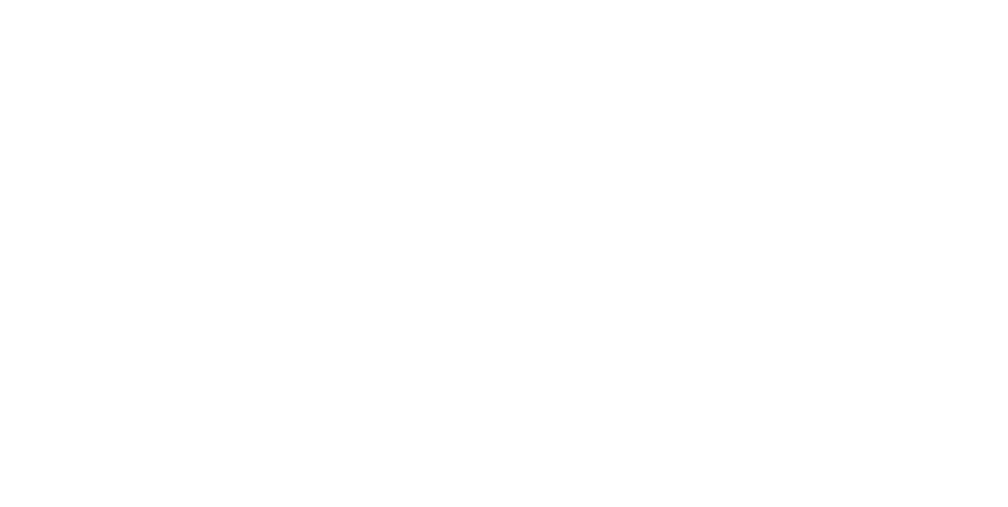
Assise 2, 1951, huile et or sur table
Taj Mahal 4, 1954, huile et or su table
D – Et leurs formes tendent à se rétrécir et à s'allonger verticalement, tandis que souvent l'espace tend à se courber.
Fred Licht a bien résumé l'impact global de ces vues, ou visions, sur l'observateur:
«[Ses architectures] reculent ou s'inclinent comme si elles allaient revenir dans une époque lointaine, après une visite magique, après une apparition fantomatique au XX siècle»
Ce qui signifie que ces perspectives vertigineuses prennent une valeur non seulement géométrique et spatiale mais aussi émotionnelle et temporelle.
Fred Licht a bien résumé l'impact global de ces vues, ou visions, sur l'observateur:
«[Ses architectures] reculent ou s'inclinent comme si elles allaient revenir dans une époque lointaine, après une visite magique, après une apparition fantomatique au XX siècle»
Ce qui signifie que ces perspectives vertigineuses prennent une valeur non seulement géométrique et spatiale mais aussi émotionnelle et temporelle.
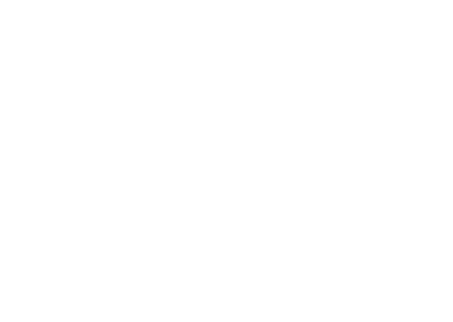
Dans son mouvement d'exode – comme quelqu'un l'a défini – Congdon a été sûrement inspiré par un texte qu'il a lu pendent la guerre et qui était devenu une sorte de livre de chevet: c'est L'Esprit des formes d'Elie Faure, une curieuse figure d'historien de l'art, érudit et collectionneur, qui a vécu à cheval entre les 19ème et 20ème siècles et qui, dans ce volume (publié en 1927), nous offre, dans une prose exubérante et d'un ton fréquemment lyrique, une grande fresque de l'histoire de l'art comparé, à travers le monde entier et toutes les époques, dans une perspective anthropologique, en cherchant à montrer l'enracinement de la production humaine dans le contexte physique et matériel, mais en essayant en même temps de surprendre en eux l'élan de l'esprit humain en train de se donner sa propre forme.
C'est une perspective anthropologique que, Congdon, je pense, a aussi partagée. Malgré sa vie solitaire, il a toujours été nostalgique de la communion-communauté humaine et très attentif aux drames collectifs.
Et je pense qu'on peut considérer sa peinture de voyage comme une sorte d'anthropologie ou d'ethnographie synthétique, par images, dans le langage très particulier de sa peinture.
C'est pour ça – et aussi pour trouver la clé de sa propre identité – qu'il s'embarque, dans la seconde moitié du 20ème siècle, en un bizarre et anachronique Grand Tour, à la suite de grands artistes du passé.
Mais je voudrais ici citer un passage du livre de Faure, qui doit avoir profondément marqué Congdon, là où sont définies la figure et la mission du peintre dans les époques de crise, quand la communion-communauté se dissout et les individus sont «désorbités» dans leurs «solitudes arides»:
«Dans ces périodes critiques redoutables, où presque tous les individus désorbités errent dans les solitudes arides de leur esprit et n'agissent plus qu'au hasard de leurs impulsions, de leurs habitudes, quelques-uns, et le peintre en particulier, portent l'héroïsme du monde. Ils n'ont pas d' autre fonction que de recréer dans leur âme, à leur manière, l'unité primitive, pour la transmettre intacte à l'organisme qui sera. Quand les colonnes du temple s'écroulent, la fonction du peintre-héros est de tendre ses deux épaules, pour en soutenir l'architrave jusqu'à ce qu'un autre approche et lui permette de mourir».
Cette idée du "peintre-héros" – qui d'ailleurs a aussi une référence "christique" ambiguë - n'était pas exempte d'un certain surhommisme que Congdon lui-même avoue, en se remémorant ces années:
«Comme si j'étais assailli par un élan cosmique d'embrasser toute la terre dans une image monumentale, je voyageais rapidement et en recherchant constamment dans les symboles rédempteurs des autres mon propre salut».
Donc, sa peinture est une enquête inquiète sur les édifices, sur les milieux que l'homme habite dans un strict entrelacement entre l'architecture et la tectonique naturelle, où souvent les deux échangent leurs rôles.
Dans tous les cas: une investigation sur les manières dont l'homme cherche un sens qui le transcende.
La précarité des oeuvres humaines qu'il a expérimentée pendant la guerre et dans l'après-guerre, hanté par le cauchemar de la bombe, rend urgente, pour lui, la tâche de déchiffrer leurs messages devenus obscurs pour l'homme d'aujourd'hui. Son Grand Tour, ce n'est pas du tourisme!
Comme l'a très bien écrit encore Licht, en comparant Congdon au grand graveur Piranesi, lui aussi a été capable d'arriver à un véritable portrait, et même à une véritable biographie des monuments peints. Et il ajoute:
«Ces biographies n'ont pas de compromis, elles mêlent admiration et terreur face au spectacle de la vie, de la mort, et de la seconde vie à laquelle renaissent les monuments quand la faculté humaine d'en reconnaître le sacré les transforme en reliques puissantes ».
Ici, Licht parle de l'admiration et de la terreur que ces images inspirent. De son côté, Congdon a écrit que la peur et la mort sont le "lieu fécondant" de ses images.
C'est une perspective anthropologique que, Congdon, je pense, a aussi partagée. Malgré sa vie solitaire, il a toujours été nostalgique de la communion-communauté humaine et très attentif aux drames collectifs.
Et je pense qu'on peut considérer sa peinture de voyage comme une sorte d'anthropologie ou d'ethnographie synthétique, par images, dans le langage très particulier de sa peinture.
C'est pour ça – et aussi pour trouver la clé de sa propre identité – qu'il s'embarque, dans la seconde moitié du 20ème siècle, en un bizarre et anachronique Grand Tour, à la suite de grands artistes du passé.
Mais je voudrais ici citer un passage du livre de Faure, qui doit avoir profondément marqué Congdon, là où sont définies la figure et la mission du peintre dans les époques de crise, quand la communion-communauté se dissout et les individus sont «désorbités» dans leurs «solitudes arides»:
«Dans ces périodes critiques redoutables, où presque tous les individus désorbités errent dans les solitudes arides de leur esprit et n'agissent plus qu'au hasard de leurs impulsions, de leurs habitudes, quelques-uns, et le peintre en particulier, portent l'héroïsme du monde. Ils n'ont pas d' autre fonction que de recréer dans leur âme, à leur manière, l'unité primitive, pour la transmettre intacte à l'organisme qui sera. Quand les colonnes du temple s'écroulent, la fonction du peintre-héros est de tendre ses deux épaules, pour en soutenir l'architrave jusqu'à ce qu'un autre approche et lui permette de mourir».
Cette idée du "peintre-héros" – qui d'ailleurs a aussi une référence "christique" ambiguë - n'était pas exempte d'un certain surhommisme que Congdon lui-même avoue, en se remémorant ces années:
«Comme si j'étais assailli par un élan cosmique d'embrasser toute la terre dans une image monumentale, je voyageais rapidement et en recherchant constamment dans les symboles rédempteurs des autres mon propre salut».
Donc, sa peinture est une enquête inquiète sur les édifices, sur les milieux que l'homme habite dans un strict entrelacement entre l'architecture et la tectonique naturelle, où souvent les deux échangent leurs rôles.
Dans tous les cas: une investigation sur les manières dont l'homme cherche un sens qui le transcende.
La précarité des oeuvres humaines qu'il a expérimentée pendant la guerre et dans l'après-guerre, hanté par le cauchemar de la bombe, rend urgente, pour lui, la tâche de déchiffrer leurs messages devenus obscurs pour l'homme d'aujourd'hui. Son Grand Tour, ce n'est pas du tourisme!
Comme l'a très bien écrit encore Licht, en comparant Congdon au grand graveur Piranesi, lui aussi a été capable d'arriver à un véritable portrait, et même à une véritable biographie des monuments peints. Et il ajoute:
«Ces biographies n'ont pas de compromis, elles mêlent admiration et terreur face au spectacle de la vie, de la mort, et de la seconde vie à laquelle renaissent les monuments quand la faculté humaine d'en reconnaître le sacré les transforme en reliques puissantes ».
Ici, Licht parle de l'admiration et de la terreur que ces images inspirent. De son côté, Congdon a écrit que la peur et la mort sont le "lieu fécondant" de ses images.
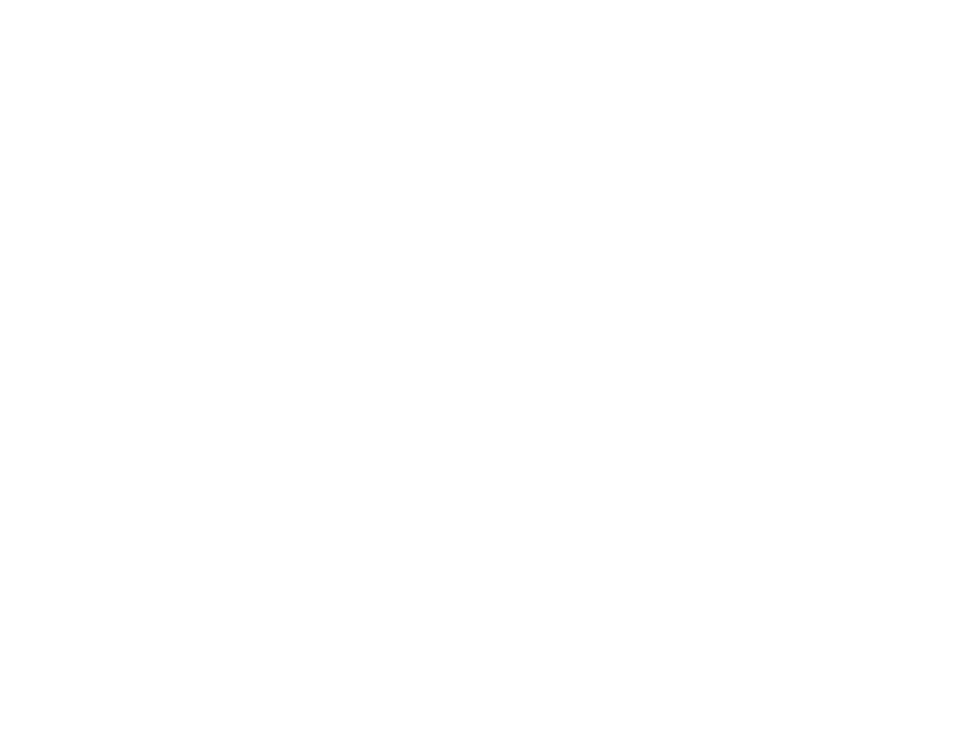
Rome, Colisée 2, 1951, huile, émail sur table
C'est par exemple le cas de son image du Colisée de Rome (1951), qui combine sur la même surface peinte deux espaces en conflit. À mesure qu'on descend vers le bas du tableau, on passe d'une vue large et détendue d'une ville lumineuse, aux couleurs chaudes, à cet énorme entonnoir brun où l'espace se rétrécit, englouti par ce grand trou surle fond. Extase et vertige vont de pair.
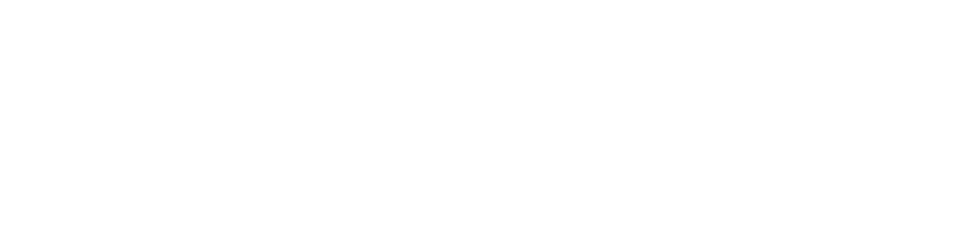

Il en va de même dans cet autre cauchemar urbain qu'est la Tour Eiffel: ici nous avons un vertige d'en bas, car la construction nous surplombe comme une créature monstrueuse, en nous aspirant vers le haut.
Tour Eiffel 3, 1955, huile, or et argent sur table
L'aspect inquiétant va s'approfondir au fil des années. Congdon lui-même le dit :
«Une présence obsessionnelle dans mes tableaux en fascinait certains et effrayait d'autres. Chaque oeuvre était la reprise d'une lutte mortelle dans l'arène de moi-même».
Maintenant les lieux qu'il va chercher sont ceux où la vie est plus directement menacée par la mort, où la vie est presque un "miracle".
A partir de 1955, trois figures surtout émergent: le désert, le volcan et le vautour.
«Une présence obsessionnelle dans mes tableaux en fascinait certains et effrayait d'autres. Chaque oeuvre était la reprise d'une lutte mortelle dans l'arène de moi-même».
Maintenant les lieux qu'il va chercher sont ceux où la vie est plus directement menacée par la mort, où la vie est presque un "miracle".
A partir de 1955, trois figures surtout émergent: le désert, le volcan et le vautour.
1 - Le pied dans le désert
«En volant d'Alger au désert la terre est comme un corps qui se décompose: en couches qui montent de la mer à la plaine fertile, jusqu'à la cime des montagnes, dernier bastion contre l'avancée du désert qui mine les fondements de la vie, lesquels, après les dernières protestations sous forme de vertèbres et de cicatrices, explosent dans le sable –dans le désert nu».
Voilà ce que Congdon écrit sur ses cahiers, en1955, pendant qu'il vole vers les trois oasis sahariennes de Touggourt, Ouargla et Ghardaia.
«En volant d'Alger au désert la terre est comme un corps qui se décompose: en couches qui montent de la mer à la plaine fertile, jusqu'à la cime des montagnes, dernier bastion contre l'avancée du désert qui mine les fondements de la vie, lesquels, après les dernières protestations sous forme de vertèbres et de cicatrices, explosent dans le sable –dans le désert nu».
Voilà ce que Congdon écrit sur ses cahiers, en1955, pendant qu'il vole vers les trois oasis sahariennes de Touggourt, Ouargla et Ghardaia.
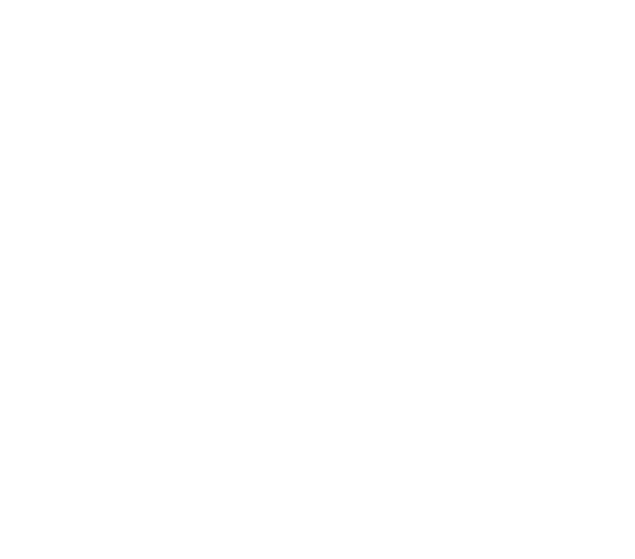
Sahara 10, 1955, huile, or et nescafé sur table
De retour à Meudon, où il avait son atelier, cette expérience du désert trouva sa conclusion dans la peinture:
«Je peignais le désert –son infini - et je pensais peut-être à mon long vagabondage là-bas. [...] Je voulais mettre mon pied dans le tableau. J'y suis entré et j'ai fait pleuvoir autour de mon pied de la terre et dans la terre j'ai mis un village arabe blanc, tout autour de mon pied».
«Je peignais le désert –son infini - et je pensais peut-être à mon long vagabondage là-bas. [...] Je voulais mettre mon pied dans le tableau. J'y suis entré et j'ai fait pleuvoir autour de mon pied de la terre et dans la terre j'ai mis un village arabe blanc, tout autour de mon pied».
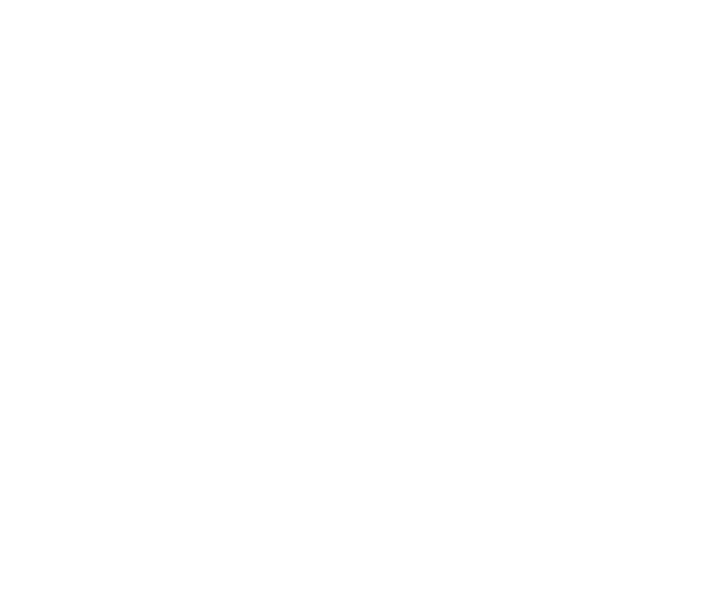
Les images de cette période ont un caractère qu'on pourrait définir "apocalyptique", au sens strictement littéral, de "révélation". La nudité du désert fait émerger le corps de l'homme, son propre corps, bien qu'à travers une de ses parties, le pied. Une intrusion dans son propre tableau correspondant à son invasion dans ce monde autre qu'est le désert. Il ne faudra pas oublier ce fait dans la suite de ce parcours, surtout quand on fera l'examen de ses crucifix.
2 - Santorin: au bord du désastre
Dans la même année Congdon va travailler pendant cinq mois dans l'île-volcan grecque de Santorin, qui a explosé plus de mille ans avant.
2 - Santorin: au bord du désastre
Dans la même année Congdon va travailler pendant cinq mois dans l'île-volcan grecque de Santorin, qui a explosé plus de mille ans avant.
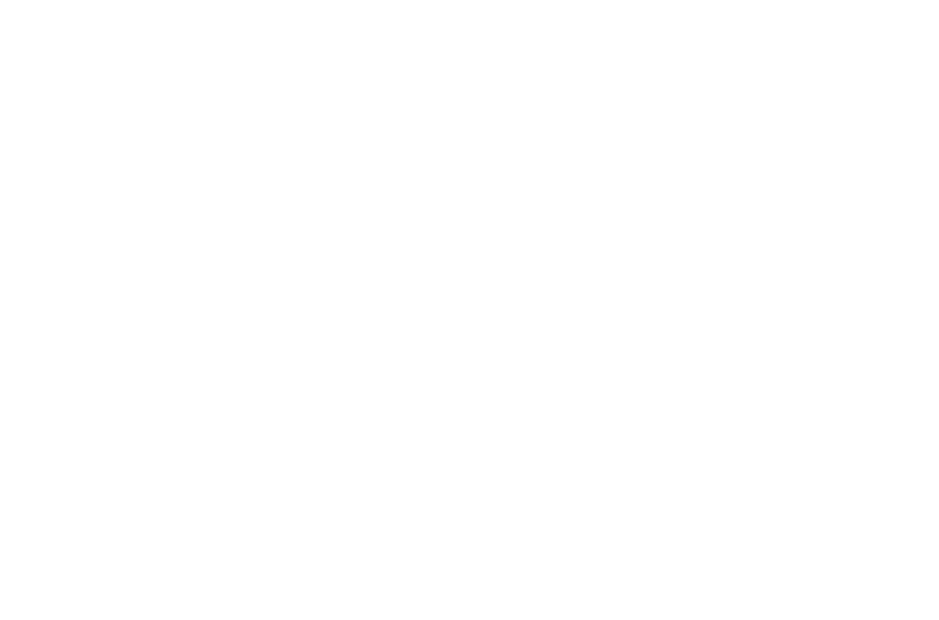
Vue de Santorin dans les années 50
Ses notes sont toujours très éloquentes:
«Les gens de Santorin semblaient ensorcelés, justement à cause de cette mort immobile chaude et noire - si seulement on pouvait l'enlever, tout irait bien pour eux. Il me semblait triste de regarder pendant la nuit cette mort carbonisée, noyée, qui autrefois fut la crête orgueilleuse, la couronne de toute la civilisation Minoenne. Je pensais aux villes ensevelies là, à 400 mètres sous l'eau – et moi sur ce bord d'un désastre qui encore maintenant respire la violence trois mille ans plus tard.»
Même ici, et plus encore, sa peinture prend un caractère apocalyptique, surtout dans son Santorin 10, où le cratère-îlot au centre de la caldeira devenue une lagune interne de Santorin se transforme en une monstrueuse colonne noire, peinte avec un pigment très épais, en relief, auquel a été mêlée de la poudre volcanique. Congdon a éliminé la surface marine interne qui cache gracieusement ce monstre qui monte d'un gouffre spatial mais aussi temporel.
«Des forces puissantes sont à l'oeuvre ici à Santorin, Dieu, le Démon et la nature... et maintenant je sens que je dois rester - livrer la bataille... la grande catastrophe autour de nous à Santorin fait partie de Dieu.»
«Et comme la mer dans le cratère est de trop je l'ai retirée et j'ai fait arriver jusqu'au fond le noyau noir laissant à la cime la vraie mer qui est à l'extérieur».
«Les gens de Santorin semblaient ensorcelés, justement à cause de cette mort immobile chaude et noire - si seulement on pouvait l'enlever, tout irait bien pour eux. Il me semblait triste de regarder pendant la nuit cette mort carbonisée, noyée, qui autrefois fut la crête orgueilleuse, la couronne de toute la civilisation Minoenne. Je pensais aux villes ensevelies là, à 400 mètres sous l'eau – et moi sur ce bord d'un désastre qui encore maintenant respire la violence trois mille ans plus tard.»
Même ici, et plus encore, sa peinture prend un caractère apocalyptique, surtout dans son Santorin 10, où le cratère-îlot au centre de la caldeira devenue une lagune interne de Santorin se transforme en une monstrueuse colonne noire, peinte avec un pigment très épais, en relief, auquel a été mêlée de la poudre volcanique. Congdon a éliminé la surface marine interne qui cache gracieusement ce monstre qui monte d'un gouffre spatial mais aussi temporel.
«Des forces puissantes sont à l'oeuvre ici à Santorin, Dieu, le Démon et la nature... et maintenant je sens que je dois rester - livrer la bataille... la grande catastrophe autour de nous à Santorin fait partie de Dieu.»
«Et comme la mer dans le cratère est de trop je l'ai retirée et j'ai fait arriver jusqu'au fond le noyau noir laissant à la cime la vraie mer qui est à l'extérieur».
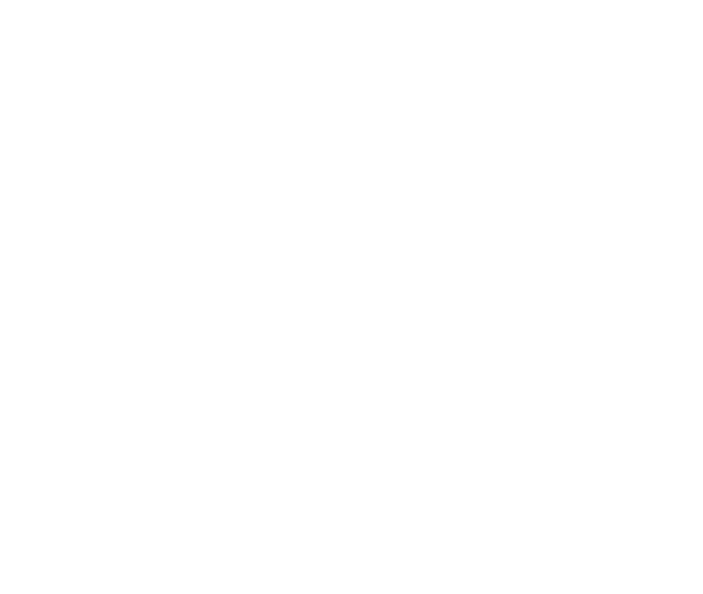
Santorin 9, 1955, huile, or, et poudre volcanique
3 – Guatemala: les "cadrans solaires de la mort"
Au Guatemala, en 1957, Congdon rencontre la troisième figure du Destin, de la Mort: les vautours. Ici aussi ce sont ses écrits (Congdon a été aussi un écrivain estimable) qui ont donné un contexte de sens à ses images:
«Je pense avoir peint ou ressenti une émotion en m'immergeant dans les vautours, comme je l'avais fait dans les ravages volcaniques de Santorin - pour m'arracher de la peau les écailles du démon, pour me libérer de leur menace de mort».
«La mort voyage vite sur ma ville, sur les ailes des vautours, avec les plumes prêtes à livrer bataille, avec leurs yeux d'agate noire, avec les pointes perlées des becs sur les ossements. Zopilotes, ce sont les yeux de la mort qui apparaissent sur la courbure du ciel indiquant avec exactitude où et comment la mort frappe à chaque instant.»
Les images de deux vautours - celui qui vole menaçant et celui qui meurt avec un dernier cri; celui qui cherche et signale la mort dont il se nourrit, et l'autre qui à son tour reçoit la mort – constituent une sorte de diptyque qui est aussi un autoportrait du peintre lui-même.
Au Guatemala, en 1957, Congdon rencontre la troisième figure du Destin, de la Mort: les vautours. Ici aussi ce sont ses écrits (Congdon a été aussi un écrivain estimable) qui ont donné un contexte de sens à ses images:
«Je pense avoir peint ou ressenti une émotion en m'immergeant dans les vautours, comme je l'avais fait dans les ravages volcaniques de Santorin - pour m'arracher de la peau les écailles du démon, pour me libérer de leur menace de mort».
«La mort voyage vite sur ma ville, sur les ailes des vautours, avec les plumes prêtes à livrer bataille, avec leurs yeux d'agate noire, avec les pointes perlées des becs sur les ossements. Zopilotes, ce sont les yeux de la mort qui apparaissent sur la courbure du ciel indiquant avec exactitude où et comment la mort frappe à chaque instant.»
Les images de deux vautours - celui qui vole menaçant et celui qui meurt avec un dernier cri; celui qui cherche et signale la mort dont il se nourrit, et l'autre qui à son tour reçoit la mort – constituent une sorte de diptyque qui est aussi un autoportrait du peintre lui-même.
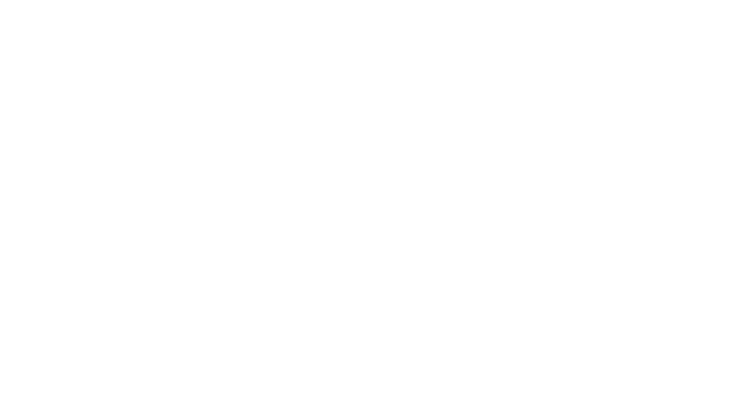
Guatemala 6 (Vautour en vol),1957
En effet, à ce stade la recherche de Congdon devient plutôt une fuite. Fuite d'une Présence harcelante, qui le poursuit, qui le pourchasse:
«Je commençais à voir dans chaque oeuvre le sursis à un possible arrêt de mort».
C'est pourquoi ces images de vautours sont comparées par Fred Licht au mystérieux chien qui chasse le protagoniste d'un poème de Francis Thompson –The Hound of Heaven, Le Chien du Ciel –où le protagoniste fuit ce chasseur inconnu, inlassable, dont il entend à un certain moment la voix:
«Rien ne va t'abriter, toi qui ne M'abrites pas».
C'est, évidemment, la voix de Dieu.
D'ailleurs, pendant sa visite au désert du Sahara, Congdon avait rencontré St Augustin dans ses Confessions qui deviennent, à partir de ce moment-là, sa lecture la plus assidue.
Et il commence à douter que son art puisse le sauver.
Comme il écrit à sa cousine, la poétesse Isabella Gardner:
«Nous [les artistes], nous payons au prix fort le fait d'arriver aussi près et de négliger le reste, sans aller plus loin avec Dieu. Mais c'est justement ce "reste" que nous voudrions créer en guise de compensation. Et, bien sûr nous n'y arrivons jamais, ce qui fait que nous sommes toujours dans la frustration. Nous créons dans la douleur de notre non-sainteté».
«Je commençais à voir dans chaque oeuvre le sursis à un possible arrêt de mort».
C'est pourquoi ces images de vautours sont comparées par Fred Licht au mystérieux chien qui chasse le protagoniste d'un poème de Francis Thompson –The Hound of Heaven, Le Chien du Ciel –où le protagoniste fuit ce chasseur inconnu, inlassable, dont il entend à un certain moment la voix:
«Rien ne va t'abriter, toi qui ne M'abrites pas».
C'est, évidemment, la voix de Dieu.
D'ailleurs, pendant sa visite au désert du Sahara, Congdon avait rencontré St Augustin dans ses Confessions qui deviennent, à partir de ce moment-là, sa lecture la plus assidue.
Et il commence à douter que son art puisse le sauver.
Comme il écrit à sa cousine, la poétesse Isabella Gardner:
«Nous [les artistes], nous payons au prix fort le fait d'arriver aussi près et de négliger le reste, sans aller plus loin avec Dieu. Mais c'est justement ce "reste" que nous voudrions créer en guise de compensation. Et, bien sûr nous n'y arrivons jamais, ce qui fait que nous sommes toujours dans la frustration. Nous créons dans la douleur de notre non-sainteté».
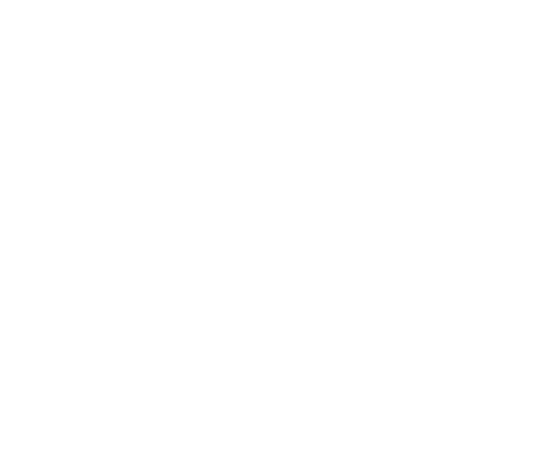
Guatemala 7 (Voutour mourant), 1957,
4 – La conversion au Crucifix et la consommation du cosmos visible - Assise
La conversion à l'église catholique, en 1959, c'est en un premier temps pour l'artiste une véritable catastrophe, une sorte de rupture dans l'économie de sa vie. Il pense même ne plus pouvoir peindre et avoir à sacrifier son art à la Foi.
Sur ce chemin difficile, il aura le confort et le guide de grandes figures du monde catholique: Jacques Maritain, Thomas Merton, Don Giovanni Rossi, Don Luigi Giussani. Et puis la lecture du Seigneurde Romano Guardini. Et dans les années 80, il fera d'autres rencontres remarquables: avec Olivier Clément et Hans Urs von Balthasar.
Sur ce chemin difficile, il aura le confort et le guide de grandes figures du monde catholique: Jacques Maritain, Thomas Merton, Don Giovanni Rossi, Don Luigi Giussani. Et puis la lecture du Seigneurde Romano Guardini. Et dans les années 80, il fera d'autres rencontres remarquables: avec Olivier Clément et Hans Urs von Balthasar.
Jacques Maritain
Thomas Merton
Le volume autobiographique "In My Disc of Gold", prefacé par Maritain et Merton
"Le Seigneur," de Romano Guardini. une des lectures les plus assidues de Congdon après sa conversion
Congdon avec Don Giovanni Rossi
Congdon avec Don Luigi Giussani
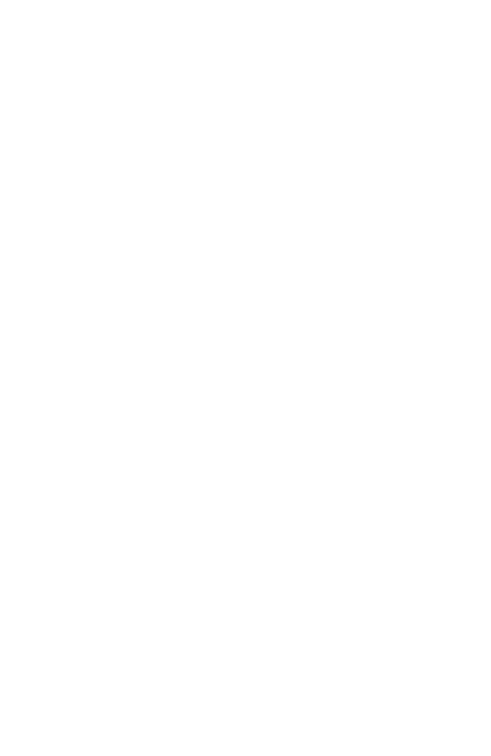
Crucifix 2, 1960, huile sur table
Au début, il cherche un compromis en peignant les sujets de la liturgie. Mais ça dure quelques années et après il revient à ses visions des villes et de la nature, dans un style plus sombre et silencieux.Mais en revanche le thème du Crucifix s'impose avec insistance pendant 20 ans et presque 200 versions. C'est la figure humaine, presque totalement bannie de sa peinture précédente, qui revient. Et il est très intéressant de constater qu'elle va occuper la place de cet élément inquiétant qu'on a vu dans ses oeuvres des années 50. Souvenons-nous du pied dans le désert.
Mais ce qui frappe dans ses crucifix et ce retour à la figure, c'est le fait que, dés le commencement, celle-ci amorce un procès de défiguration, visible déjà dans les premières épreuves, comme le Crucifix 2 de 1960: le visage est caché par les cheveux, la tête tombe au-dessous des épaules.
Le Christ, ici, c'est un aprósopon, un "sans-visage", et même acéphale, "sans-tête". Celle-ci plutôt ressemble à une cicatrice, à une blessure, qui tend à descendre vers le coeur.
Mais ce qui frappe dans ses crucifix et ce retour à la figure, c'est le fait que, dés le commencement, celle-ci amorce un procès de défiguration, visible déjà dans les premières épreuves, comme le Crucifix 2 de 1960: le visage est caché par les cheveux, la tête tombe au-dessous des épaules.
Le Christ, ici, c'est un aprósopon, un "sans-visage", et même acéphale, "sans-tête". Celle-ci plutôt ressemble à une cicatrice, à une blessure, qui tend à descendre vers le coeur.
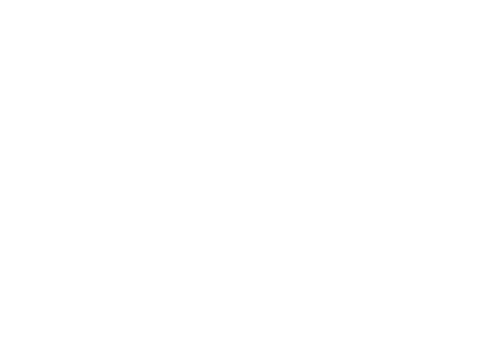
D'ailleurs, voilà ce qu'écrit Congdon à ce sujet:
«La rencontre avec le Christ, après 1959, me fait découvrir que le drame de sa croix est aussi le mien. Et c'est ce qui me porte vers le Crucifix à travers un retour à la figure, figure à ne plus jamais voir ou peindre, détachée de la croix. La figure ne m'intéressait pas en soi, mais la figure comme croix, en ce que la croix fait du corps du Christ.»
«Le corps rencontré est mon propre corps chargé de péchés, corps imprégné de douleur au point de ne plus distinguer le corps de la douleur. comme si la douleurétait presque devenue le corps et non pas le corps devenu douleur.»
«La rencontre avec le Christ, après 1959, me fait découvrir que le drame de sa croix est aussi le mien. Et c'est ce qui me porte vers le Crucifix à travers un retour à la figure, figure à ne plus jamais voir ou peindre, détachée de la croix. La figure ne m'intéressait pas en soi, mais la figure comme croix, en ce que la croix fait du corps du Christ.»
«Le corps rencontré est mon propre corps chargé de péchés, corps imprégné de douleur au point de ne plus distinguer le corps de la douleur. comme si la douleurétait presque devenue le corps et non pas le corps devenu douleur.»
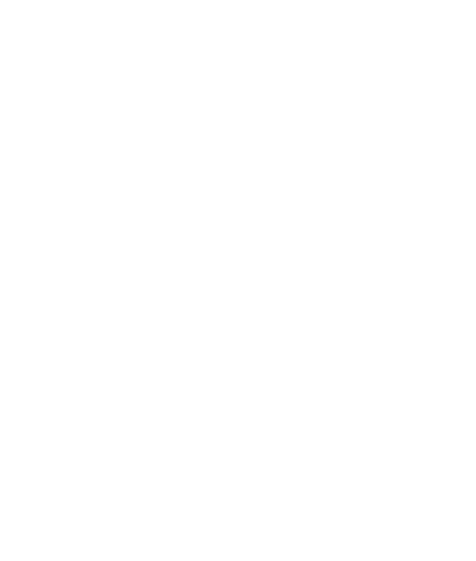
Crucifix 34, 1966, huile sur table
Ce procès de défiguration et de consommation de la figure se poursuit dans les années suivantes avec de fréquentes contaminations avec les sujets habituels de sa peinture de voyage – les vues urbaines et naturelles – que, comme nous l'avons déjà anticipé, il reprend surtout dans les années 70.
Voyons-en quelques essais.Par exemple dans le tableau Corrida de 1970, où sur la masse noire du taureau se superpose une tâche rougeâtre de sang, tout-à-fait pareille à la tête du Crucifix.
Voyons-en quelques essais.Par exemple dans le tableau Corrida de 1970, où sur la masse noire du taureau se superpose une tâche rougeâtre de sang, tout-à-fait pareille à la tête du Crucifix.
Mais trois ans après, il peint la forme allongée d'un bateau à demi brûlé à la suite d'un accident tragique, entre l'Italie et la Grèce. Il en peint plusieurs versions, jusqu'au moment où il fait le geste de tourner le tableau pour assimiler le bateau brûlé au corps souffrant de Jésus.
Mais c'est surtout dans l'enfer des grandes villes du monde, la violence à peine retenue du trafic des voitures sur le macadam, au milieu de la misère des bidonvilles du Tiers Monde, que la figure du Crucifié émerge encore plus méconnaissable dans sa peinture. Ainsi qu'il écrit après son voyage à Bombay en 1973:
«Ce qui m'a frappé le plus à Bombay, c'est une longue rue -rue pleine d'un trafic qui ne serait pas différent de celui de n'importe quelle grande rue dans le monde d'aujourd'hui, si ce n'est qu'elle passait à travers une misère indicible, dans laquelle la marée boueuse des baraques et des gens avait été réduite - indistinctement les unes et les autres - à un enfer!»
«Ce qui m'a frappé le plus à Bombay, c'est une longue rue -rue pleine d'un trafic qui ne serait pas différent de celui de n'importe quelle grande rue dans le monde d'aujourd'hui, si ce n'est qu'elle passait à travers une misère indicible, dans laquelle la marée boueuse des baraques et des gens avait été réduite - indistinctement les unes et les autres - à un enfer!»
De ces figures blanchâtres, semblables à des larves (les corps des miséreux collés au bitume de la rue, enveloppés dans leur robe) naît Crucifix 64, une sorte de larve aussi, peint avec de la cendre mêlée à la couleur.
Et encore, le Crucifix le plus "informel" qu'il ait jamais peint, le Crucifix 90, une coulée de bitume d'une épaisseur exceptionnelle, comparable au monstre noir de Santorin:
«Le bitume de la rue est devenu Christ qui est devenu bitume. Pour se laisser écraser jusqu'à couler, dans le feu de l'amour, au-delà de toute frontière -il coule partout, plus au-delà encore, dans les débris de cendre comme un bombardement de haine. C'est tout: un péché sans limite. Pourtant, en dessous et à travers la "coulée", la forme tient, c'est à dire l'image qui sauve!»
Et encore, le Crucifix le plus "informel" qu'il ait jamais peint, le Crucifix 90, une coulée de bitume d'une épaisseur exceptionnelle, comparable au monstre noir de Santorin:
«Le bitume de la rue est devenu Christ qui est devenu bitume. Pour se laisser écraser jusqu'à couler, dans le feu de l'amour, au-delà de toute frontière -il coule partout, plus au-delà encore, dans les débris de cendre comme un bombardement de haine. C'est tout: un péché sans limite. Pourtant, en dessous et à travers la "coulée", la forme tient, c'est à dire l'image qui sauve!»
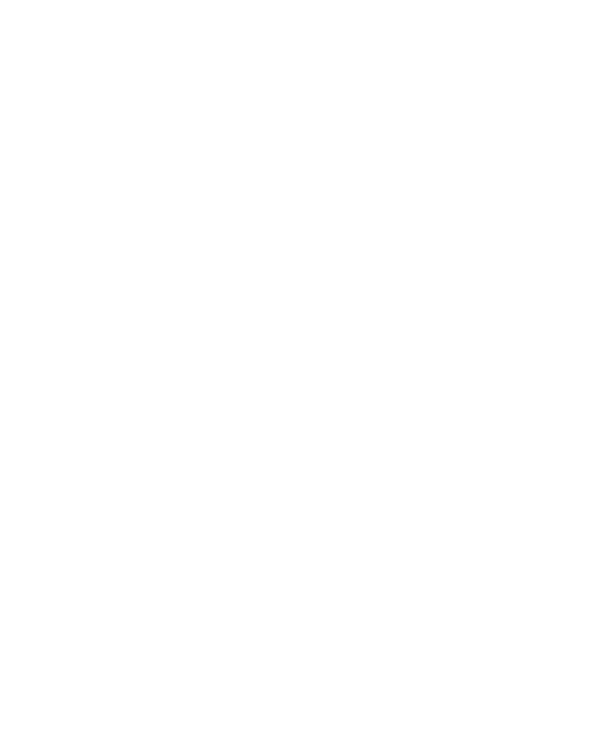
Crucifix 90, huile et cendres sur table
À ce stade – en suivant les suggestions de Pierluigi Lia dans son bel article sur les Crucifix de Congdon – on peut dire qu'il y a deux façons par lesquelles la figure du Crucifié émerge dans la peinture de Congdon.
- La première nous l'avons déjà vue: c'est le Crucifié qui vient de l'extérieur, suggéré par les visions et par les expériences du monde, qui à un certain moment s'ouvrent en révélant leur nature "christique", c'est-à-dire le Christ comme forme de toutes les formes, sujet de tous les sujets – un sujet au second degré, on pourrait dire.
- Mais après il y a le Crucifix – ou Crucifié – qui naît de l'intérieur de l'artiste lui-même, comme sa participation très intime au sacrifice du Christ, à sa consommation obéissante à la volonté du Père, qui se laisse garder dans les ténèbres de la nuit du Samedi Saint.
- La première nous l'avons déjà vue: c'est le Crucifié qui vient de l'extérieur, suggéré par les visions et par les expériences du monde, qui à un certain moment s'ouvrent en révélant leur nature "christique", c'est-à-dire le Christ comme forme de toutes les formes, sujet de tous les sujets – un sujet au second degré, on pourrait dire.
- Mais après il y a le Crucifix – ou Crucifié – qui naît de l'intérieur de l'artiste lui-même, comme sa participation très intime au sacrifice du Christ, à sa consommation obéissante à la volonté du Père, qui se laisse garder dans les ténèbres de la nuit du Samedi Saint.
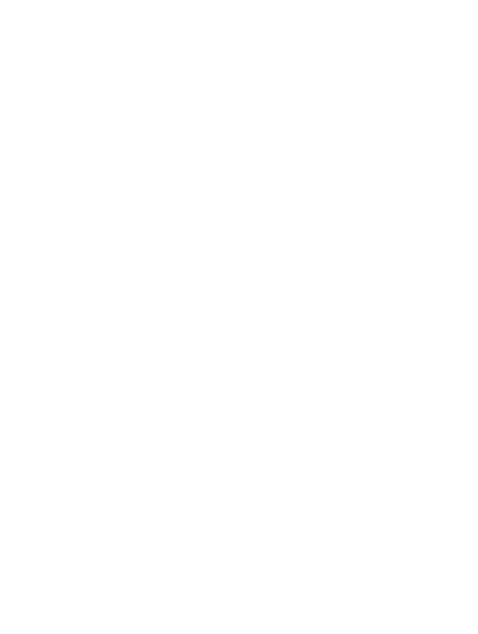
Crucifix 105, 1974, huile sur table
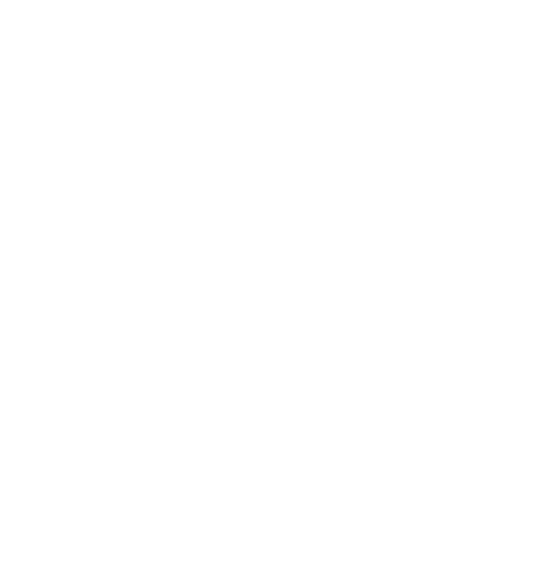
Crucifix 165,1977, huile, or et argent sur table
Ici le Christ se plante comme la graine de la nouvelle création qui naîtra de la consommation de chaque forme et de chaque figure. Devenu une barre suspendue dans l'espace vide et sombre – qui parfois nous rappelle les figures de Giacometti – le Crucifié c'est la forme élémentaire de laquelle peut sortir la nouvelle création.
Dans ces Crucifix-barres nous assistons à un véritable tour de force, de la part de Congdon, pour surprendre le moment où, à partir de la mort, on peut déjà deviner le "premier mouvement de la résurrection".
Ce qui fait dire à Pierluigi Lia que, tandis que les images traditionnelles du Crucifix sont conçues à partir du matin de la Résurrection – et donc sont des crucifix "après" - «les Crucifix de Congdon sont "avant", dans l'Heure des ténèbres où le Fils s'effondre, totalement consommé, dans la volonté du Père, dans l'instant sans lieu et sans temps où le Père seul, dans l'abîme déchirant du dessaisissement de l'amour, garde sa vie inconditionnellement consignée en un geste d'obéissance trinitaire.»
Une méditation en peinture sur le mystère du Samedi Saint, où Congdon rejoint les réflexions de la grande théologie du XXème siècle: celle de Hans Urs von Balthasar et de Benoît XVI même.
Dans ces Crucifix-barres nous assistons à un véritable tour de force, de la part de Congdon, pour surprendre le moment où, à partir de la mort, on peut déjà deviner le "premier mouvement de la résurrection".
Ce qui fait dire à Pierluigi Lia que, tandis que les images traditionnelles du Crucifix sont conçues à partir du matin de la Résurrection – et donc sont des crucifix "après" - «les Crucifix de Congdon sont "avant", dans l'Heure des ténèbres où le Fils s'effondre, totalement consommé, dans la volonté du Père, dans l'instant sans lieu et sans temps où le Père seul, dans l'abîme déchirant du dessaisissement de l'amour, garde sa vie inconditionnellement consignée en un geste d'obéissance trinitaire.»
Une méditation en peinture sur le mystère du Samedi Saint, où Congdon rejoint les réflexions de la grande théologie du XXème siècle: celle de Hans Urs von Balthasar et de Benoît XVI même.
5 – Un arrêt de vie – embrasser à nouveau le cosmos - Milan
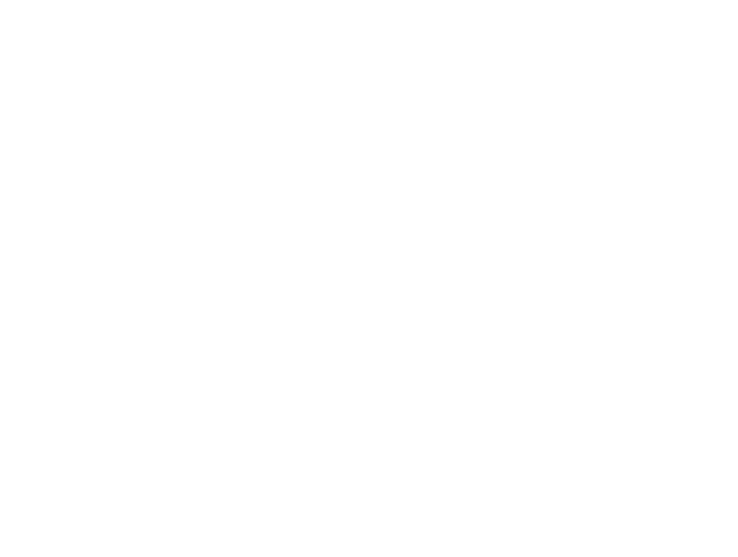
Congdon au milieu des champs de Buccinasco, près de sa maison-atelier. Photo Elio Ciol, 1980
En 1979, Congdon laisse la ville d' Assise, où il avait habité presque 20 ans, et il va s'installer dans l'enceinte d'un monastère bénédictin, une ferme dans la plaine de Lombardie: c'est le dernier tournant de sa vie et de son art.
Il commence son dernier voyage, il dit, en s'arrêtant, car il ne voyagera plus. C'est un arrêt, pas de mort, mais plutôt de vie.
Et il ne va plus peindre de crucifix.
Que s'est-il passé?
Mon hypothèse c'est que la confrontation serrée avec le corps et la chair du Christ des années précédentes, qui l'avait fait effondrer dans les ténèbres a-cosmiques du Samedi Saint, maintenant va lui rendre possible d'embrasser à nouveau le cosmos visible. La chair consommée du Crucifié lui fait découvrir la chair rédimée de la terre.
Il commence son dernier voyage, il dit, en s'arrêtant, car il ne voyagera plus. C'est un arrêt, pas de mort, mais plutôt de vie.
Et il ne va plus peindre de crucifix.
Que s'est-il passé?
Mon hypothèse c'est que la confrontation serrée avec le corps et la chair du Christ des années précédentes, qui l'avait fait effondrer dans les ténèbres a-cosmiques du Samedi Saint, maintenant va lui rendre possible d'embrasser à nouveau le cosmos visible. La chair consommée du Crucifié lui fait découvrir la chair rédimée de la terre.
Et justement dans le humus, dans le terrain humble et fécond de cette plaine plate –une "platitude" pourrait-on dire, dans la mesure où elle n'a pas d'attrait évident, avec ses partitions régulières en rectangles et carrés de champs, délimités par des rangées de peupliers et par des canaux d'irrigation.
Où tout est nature et en même temps produit du patient travail de l'homme. Lui-même dira: «je suis devenu paysan en peinture».
Le mouvement dans l'espace est remplacé par le mouvement dans le temps: cette terre n'est pas statique, immobile, au contraire elle subit des transformations incessantes, à cause des changements de saisons, de la rotation des cultures et des phénomènes météorologiques - la pluie, la neige, le brouillard et les brumes.
Son geste avec la spatule reste toujours énergétique, mais il se laisse discipliner dans les partitions régulières des champs de couleur qui imitent la couleur des champs. Et l'incision perd son caractère agressif, dès lors que le poinçon est remplacé par une sorte de peigne qui sillonne les pâtes de couleur comme la charrue le fait avec la terre.
Où tout est nature et en même temps produit du patient travail de l'homme. Lui-même dira: «je suis devenu paysan en peinture».
Le mouvement dans l'espace est remplacé par le mouvement dans le temps: cette terre n'est pas statique, immobile, au contraire elle subit des transformations incessantes, à cause des changements de saisons, de la rotation des cultures et des phénomènes météorologiques - la pluie, la neige, le brouillard et les brumes.
Son geste avec la spatule reste toujours énergétique, mais il se laisse discipliner dans les partitions régulières des champs de couleur qui imitent la couleur des champs. Et l'incision perd son caractère agressif, dès lors que le poinçon est remplacé par une sorte de peigne qui sillonne les pâtes de couleur comme la charrue le fait avec la terre.
Et dans Champ d'orge, 1982, il arrive à utiliser le pinceau, mais seulement pour caresser la surface de la couleur en y introduisant ces vagues qui donnent la luminosité aquatique des champs d'orge.
Et la couleur prend de plus en plus le dessus. Congdon a toujours été un coloriste exquis, mais la couleur ne venait pas au premier plan, par l'exubérance du geste et des effets de texture et de relief. Ou, du moins, il privilégiait une certaine tonalité générale ou des contrastes violents ombre-lumière, avec des effet de miroitement, aux dépens des couleurs locales. Mais maintenant on assiste à une sorte d'apothéose de la couleur dont les tons deviennent de plus en plus clairs.
S'il y a un thème dominant pendant cette période, c'est précisément le dialogue varié entre la terre et le ciel, qu'il rend avec des configurations de l'espace très nouvelles, qui semblent parfois le conduire vers une peinture franchement abstraite.
Dans certains cas, on trouve encore la vertigineuse perspective d'autrefois, qui va se bloquer contre la ligne de l'horizon, toujours très haut, dans une vue à vol d'oiseau.
Et la couleur prend de plus en plus le dessus. Congdon a toujours été un coloriste exquis, mais la couleur ne venait pas au premier plan, par l'exubérance du geste et des effets de texture et de relief. Ou, du moins, il privilégiait une certaine tonalité générale ou des contrastes violents ombre-lumière, avec des effet de miroitement, aux dépens des couleurs locales. Mais maintenant on assiste à une sorte d'apothéose de la couleur dont les tons deviennent de plus en plus clairs.
S'il y a un thème dominant pendant cette période, c'est précisément le dialogue varié entre la terre et le ciel, qu'il rend avec des configurations de l'espace très nouvelles, qui semblent parfois le conduire vers une peinture franchement abstraite.
Dans certains cas, on trouve encore la vertigineuse perspective d'autrefois, qui va se bloquer contre la ligne de l'horizon, toujours très haut, dans une vue à vol d'oiseau.
Mais cette ligne d'horizon devient de plus en plus inquiète: elle va se courber, mais parfois il y a des invasions réciproques, une sorte d'emboîtement entre le ciel et la terre.
Et les accidents météorologiques, telle la pluie, vont jusqu'à abolir la distinction entre les deux.
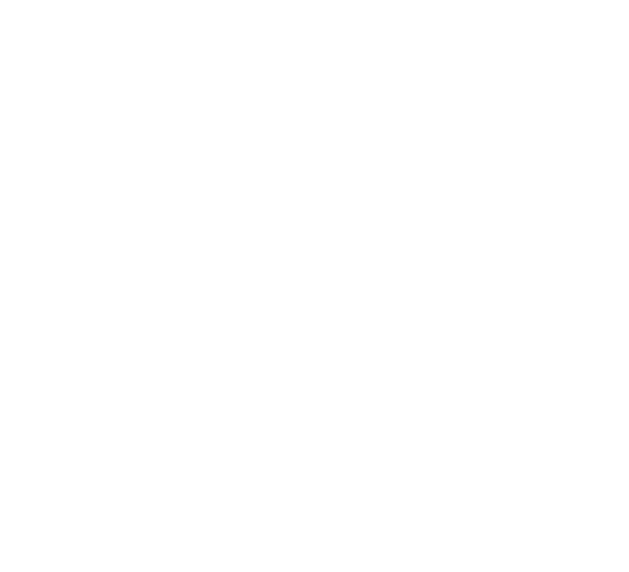
Pluie, 1988, huile et peinture métallique sur table
Et la neige peut provoquer une sorte de renversement des valeurs entre la terre et le ciel:
«N'as-tu jamais pensé que la neige c'est le ciel qui se vide de son sang qui est sa lumière? Tu verras aujourd'hui que toute sa lumière se trouve sur la terre couverte par la lumière du ciel, tandis que le ciel, en tant que lumière, n'existe plus».
«N'as-tu jamais pensé que la neige c'est le ciel qui se vide de son sang qui est sa lumière? Tu verras aujourd'hui que toute sa lumière se trouve sur la terre couverte par la lumière du ciel, tandis que le ciel, en tant que lumière, n'existe plus».
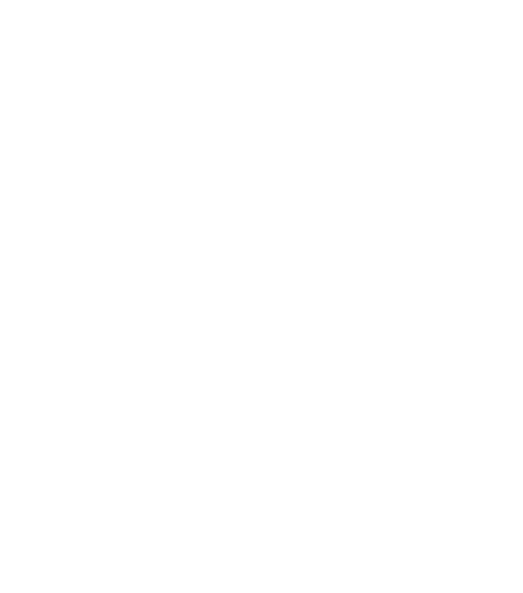
Neige10, 1985, huile et poudre d'argent sur table
Et la brume, quant à elle, devient comme un réceptacle où les champs sont de simples notes de couleur, mais sans perdre leur aspect physique. Les champs ne sont plus représentés, mais plutôt présentés dans le corps même dans lequel la couleur s'est transformée - on pourrait dire: transsubstantiée.
Ou bien il se produit aussi un renversement de l'horizon: en tournant le tableau, l'horizon se fait vertical, comme dans Neige ciel 3 de 1987, une oeuvre d'une économie réellement minimaliste: une seule note de couleur, plus sombre à gauche (le ciel), plus claire à droite (la terre, la neige) et puis cette bande de division centrale où transparaît le noir de la table, une sorte de déchirure qui sépare et unit en même temps. Et Congdon dira que sa grande découverte est que l'horizon c'est l'homme, parce que la vie de l'homme se déroule sur l'horizon.
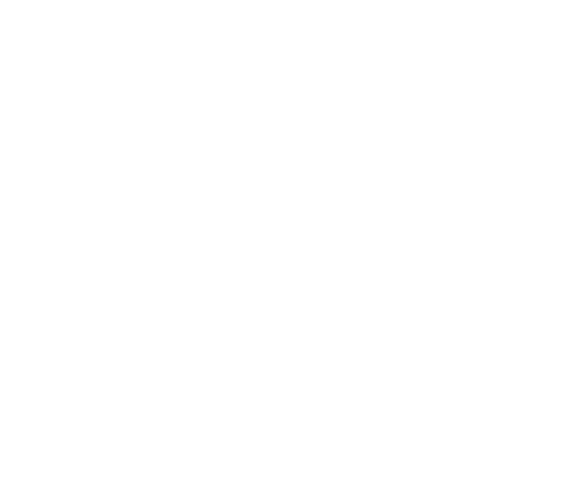
Neige ciel 3, 1987, huile sur table
On peut dire que le grand thème de sa peinture ces années peut se résumer en un titre, celui de sa dernière exposition à Rimini en 1997, huit mois avant sa mort: Cielo è terra, "Le ciel est la terre".
À ce propos, je veux terminer en examinant un tableau de 1985, dont le titre est Virgo Potens.
À ce propos, je veux terminer en examinant un tableau de 1985, dont le titre est Virgo Potens.
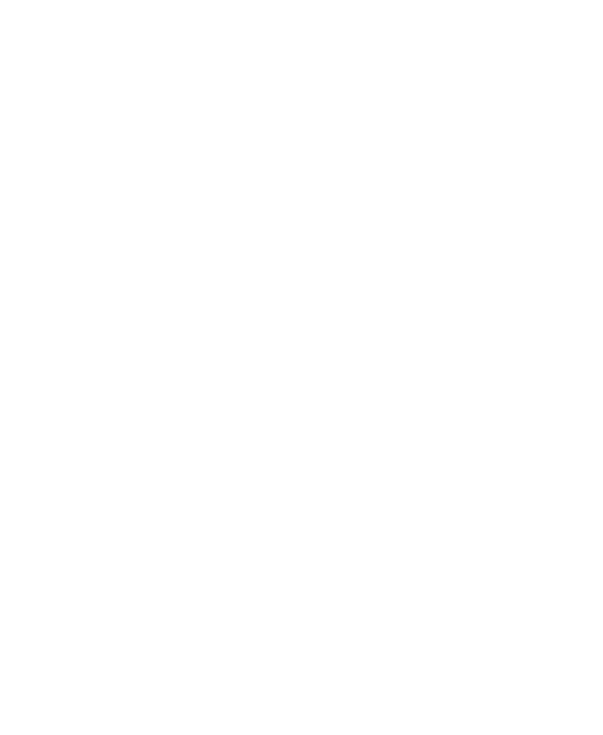
Virgo Potens, 1985, huile sur table
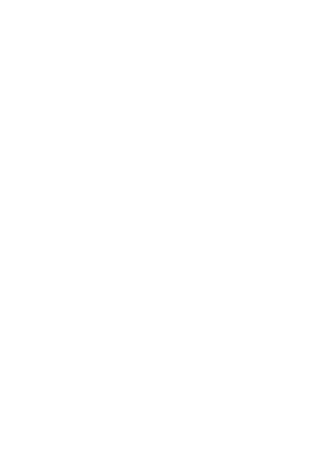
Fred Licht l'a défini «un persiflage de Mondrian», dans le sens que Congdon fait semblant d'imiter le grand maître hollandais, mais justement pour affirmer sa totale extranéité au langage et à la conception de l'art de celui-ci.
Il suffit de considérer l'irrégularité des bords des champs de couleur et surtout le fait que, par exemple, le jaune de Congdon n'est pas une couleur absolue, une valeur chromatique abstraite, mais un principe d'irradiation lumineuse. Il est aussi tactile dans sa chaleur, et on peut y deviner les champs de blés mûrs en été. C'est donc toujours de la terre, de la terre de ce monde-ci, mais comme si elle était vue de l'autre côté, comme s'il y avait une fenêtre qui s'ouvre vers nous d'un autre monde qui entre dans ce monde-ci. Et la composition du tableau a précisément une structure à fenêtre, avec le cadre formé par les notes vertes différentes en luminosité et en saturation, dans lequel explose le grand carré jaune qui est toujours de la terre, mais transfigurée par la lumière. D'où le titre. Virgo Potens, qui nous renvoie aux litanies de la Vierge.
C'est un titre donné après coup, comme cela arrive souvent dans l'art contemporain, et il n'a pas été donné par Congdon lui-même mais par son ami Paolo Mangini. Mais Congdon l'a assumé. Comme cela arrive aussi pour d'autres tableaux de cette période: Janua coeli, de la même année, et le Nom de Marie. Cette référence mariale semble nous donner une clé, ou une des clés, pour lire cette dernière saison de peinture.
Il suffit de considérer l'irrégularité des bords des champs de couleur et surtout le fait que, par exemple, le jaune de Congdon n'est pas une couleur absolue, une valeur chromatique abstraite, mais un principe d'irradiation lumineuse. Il est aussi tactile dans sa chaleur, et on peut y deviner les champs de blés mûrs en été. C'est donc toujours de la terre, de la terre de ce monde-ci, mais comme si elle était vue de l'autre côté, comme s'il y avait une fenêtre qui s'ouvre vers nous d'un autre monde qui entre dans ce monde-ci. Et la composition du tableau a précisément une structure à fenêtre, avec le cadre formé par les notes vertes différentes en luminosité et en saturation, dans lequel explose le grand carré jaune qui est toujours de la terre, mais transfigurée par la lumière. D'où le titre. Virgo Potens, qui nous renvoie aux litanies de la Vierge.
C'est un titre donné après coup, comme cela arrive souvent dans l'art contemporain, et il n'a pas été donné par Congdon lui-même mais par son ami Paolo Mangini. Mais Congdon l'a assumé. Comme cela arrive aussi pour d'autres tableaux de cette période: Janua coeli, de la même année, et le Nom de Marie. Cette référence mariale semble nous donner une clé, ou une des clés, pour lire cette dernière saison de peinture.
Et pour conclure sur ce sujet, je donne la parole encore à Fred Licht:
«Tandis que Kandinsky (ou même Rothko) laissent derrière eux les réalités humaines tangibles, Congdon nous introduit dans l'immanence et l'ubiquité d'une force divine devenue manifeste dans tout ce que nous pouvons connaître à travers nos cinq sens, à travers notre compréhension intellectuelle et émotionnelle de l'expérience. Son art, comme sa religion, se fonde essentiellement sur la transsubstantiation de la réalité et non sur sa sublimation».
Rodolfo Balzarotti
©The William Congdon Foundation www.congdonfoundation.com
«Tandis que Kandinsky (ou même Rothko) laissent derrière eux les réalités humaines tangibles, Congdon nous introduit dans l'immanence et l'ubiquité d'une force divine devenue manifeste dans tout ce que nous pouvons connaître à travers nos cinq sens, à travers notre compréhension intellectuelle et émotionnelle de l'expérience. Son art, comme sa religion, se fonde essentiellement sur la transsubstantiation de la réalité et non sur sa sublimation».
Rodolfo Balzarotti
©The William Congdon Foundation www.congdonfoundation.com